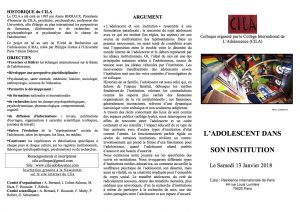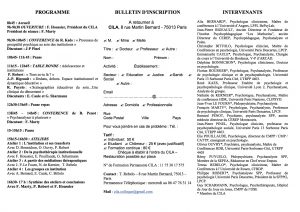Des oiseaux
La forêt normande où nous allions depuis quelques générations se vide peu à peu de ses musiciens attitrés. Les arbres perdent leurs chantres. La cathédrale végétale qu’évoquait Chateaubriand devient un monument muet. Nous y marchons toujours. Mais quelle solitude que celle de l’homme, quand peu à peu le monde vivant se retire !
Tant il est vrai que les oiseaux veillaient sur nous. Ils nous gardaient avec le ciel dans cette sorte de transparence spirituelle qui nous rendait plus proches ceux que nous appelions « les anges ». Cela bien sûr remontait de loin : le temps de notre enfance, retrouvant ses ailes, nous revenait. Nous volions comme aucun avion. D’abord parce que les oiseaux sont faits de chair et n’en dessinent pas moins avec leurs corps des figures de liberté. Leur légèreté vivante nous rend familière la possibilité de l’âme. Mais c’est aussi l’âme agrandie d’un vol qui en inspire beaucoup d’autres. Notre individualité trompeuse est aspirée par la nuée de ces chanteurs célébrant le jour. Un peuple fraternel m’appelle au loin. Que ce petit « moi » perdu de l’homme, oisillon tombé du nid, se raccroche au ciel, si la terre lui est hostile !
Et en effet nous marchions dans la forêt comme si c’était le ciel et la nuit même de ce ciel, et tout cela empli d’étoiles sonores, qui nous rattachaient à notre vie plus large. Promesse que connaissaient aussi bien ceux qui, dans le désert, approchent la musicalité cosmique, telle qu’elle leur semble les mettre au diapason de l’univers. Car oui ! les oiseaux sont des prophètes. Ils annoncent le temps transfiguré de l’espace, et, s’adressant au plus intime – à l’inaccessible identité du vivant – ils nous dévoilent le mouvement de l’être, ce vol par qui nos pensées mêmes, survolant pour ainsi dire notre corps, nous associent à un corps beaucoup plus grand qui pourrait être l’air, ou cette matière plus rare que nous appelons l’esprit.
Mais l’oiseau, le merle qui vient en plein Paris se poser devant notre fenêtre ? Je crois qu’il nous invite à nous saisir d’une espérance plus humble. Ni la gloire du Panthéon tout proche, ni celle des monuments qui l’entourent, ne nous délivrent du sentiment que nous avons de notre fragilité. Notre corps ne pèse pas lourd devant les forces qui l’assiègent et notre esprit lui-même peut nous conduire à notre perte. N’est-ce pas ce qui arrive lorsque la rationalité – comme nous le voyons autour de nous – déploie les armes de sa folie et crée les engloutissements qui nous savons ? On nous a dit : le Monde et l’Homme seront sauvés par les chiffres (les bons chiffres), cette grande machine à broyer les oiseaux. Mais les oiseaux sont aussi les symboles qui, par-delà même la quantité de toute vie, nous assurent d’une qualité qui échappe aux mots pour la dire (sauf sans doute plus d’une fois en poésie) et aux objets promus de notre monde en forme de boutique.
Que les oiseaux gardent pour eux le secret d’une aventure dont personne n’a le fin mot ne les empêche pas de marquer le ciel du signe clair et obscur qui est celui du « passage », cette vérité imprenable de toute vie ! S’ils « ne sèment ni ne moissonnent », nous ne les prendrons pourtant pas pour ces joyeux utopistes d’un monde enfin purifié. C’est plutôt qu’ils nous invitent à regarder le monde à travers les yeux de notre premier regard fait de surprise et de crainte, comme tout aussi bien du désir d’entrer dans une vie plus vaste. Car notre enfance, en tant qu’elle s’y coulait, nous ouvrait le monde. Pour peu qu’on nous en ait appris le partage, ne nous revient-il par encore de sacrifier notre désir de puissance à la réalité dont, adultes, nous nous voulons les maîtres ? Car le bonheur n’est-il pas encore et toujours celui de la rencontre ? L’écologie n’est pas un arrangement technique avec ce que nous appelons la nature ; elle est aussi, comme le chant des oiseaux, le plaisir d’être au monde avec le monde. La morale même vient après. « Ils ne sèment ni ne moissonnent », ni ne prêchent. L’éducation devrait bien nous apprendre à garder de notre enfance et des oiseaux le meilleur de l’homme : aimer la vie là où la sensibilité et la pensée se soutiennent pour célébrer son miracle.
C’est donc bien de naître et de renaître qu’il s’agit, y compris sans doute dans le mourir. « Notre dieu inconnu » chante avec l’oiseau. Il se tient devant nous à la fenêtre du monde.
Jean-Pierre Bigeault
Avril 2018