Le temps qu’il fait
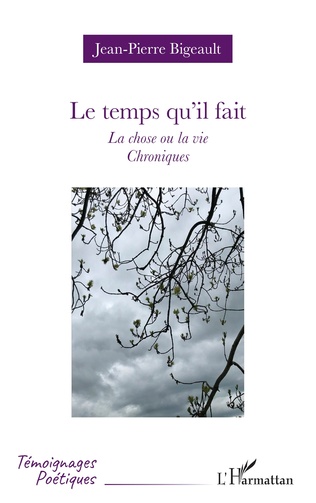
La chose ou la vie - Chroniques
« Le temps qu’il fait » est une chronique. Au-delà des évènements qui marquent notre époque, le débat qui tourne à la violence concerne les valeurs, et précisément celles de la République. Une crise est ouverte. Dans un monde voué à la Chose, quelle devient la place de la personne ? Quelle vérité de l’Humain peut nous guider, dans cette réappropriation de nous-même ? Comme au temps d’une guerre oubliée, la Poésie peut inspirer et soutenir les combats de la pensée du « temps qu’il fait ».
L'Harmattan - Témoignages poétiques - 2024
Cliquer ici pour commander le livre sur le site de l'éditeur
Mon dernier livre intitulé « Le temps qu’il fait » répond à une préoccupation ancestrale. Les paysans de ma propre famille connaissaient fort bien cette expression, et pour cause !
S’agissant plus précisément de notre vie actuelle, on peut dire qu’un brouillard épais – qui se fait passer pour de la lumière – bouscule notre climat et brouille déjà notre horizon … en attendant mieux !
J’ai donc décidé de dire ce que je pense de tout cela au risque de déplaire.
Mes impressions, tentatives d’analyse et propositions sont certainement discutables. Mais l’état des lieux reste la clef d’une situation répétitive, pour ne pas dire bloquée, et qui affecte la vie de chacun.
En toutes ces tribulations, ce qui me frappe c’est l’affaissement de l’idée de République. A force de se laisser prendre pour une sorte d’Eglise bel et bien théorique, l’institution démocratique se perd dans ses médiocres « calculs » (en particulier d’égos), pour ne pas dire dans sa perversion. Je pense, sur un tel sujet, que ce qui se passe avec ce qu’on ose encore appeler « l’Education nationale » en dit plus long que tous les discours. On se moque en vérité de l’éducation. On est partis de l’idée générale et positive de « l’école pour tous » sans vouloir penser que l’Ecole ne répond plus seulement à ce qu’on a appelé, autrefois, « l’Instruction publique ». Elle doit lutter aujourd’hui, non seulement contre l’inégalité des chances, mais l’égoïsme, le narcissisme et le culte de l’argent ; C’est l’urgence d’un pays développé et … républicain !
Or, au nom de la liberté et des Droits de l’Homme (d’à côté, voire d’ailleurs) on a sacrifié l’égalité et la fraternité à l’instruction globalement médiocre, ou d’ailleurs exceptionnellement « poussée » … pour les meilleurs, tels les athlètes, d’une population divisée et ambigüe vis-à-vis d’une classe dirigeante qui la méprise.
Ironie de l’Histoire, le prix à payer de cet échec est dans toutes les bouches. Il porte le nom magique de « retour à l’autorité ». Or, quand une culture comme la nôtre ne sait même plus ce que veut dire le mot « éduquer » - ni même bien sûr de quoi l’autorité est faite – autant en revenir à un gri-gri du désert le plus profond. Le modèle faussement militaire de l’Ecole est dépassé mais l’Ecole fabrique des « soldats perdus » pour la République. Car la République doit être réinventée. Qu’on s’intéresse plutôt à l’éducation comme à une science intelligente et à un art sensible et néanmoins nécessaire.
Mais l’Ecole n’est qu’un aspect, et d’ailleurs aussi bien un symptôme tout autant que la cause de notre déficit républicain. Lequel, s’il se concrétise dans l’extension du domaine de « l’assistanat » n’en traduit pas moins une misère morale dont la violence n’est que l’une des expressions. Quand un Président ose évoquer à ce sujet un phénomène de « dé civilisation », que ne voit-il ce qui va mal – vraiment mal – et avec les bonnes lunettes d’un observateur averti !
Mon livre va donc déplaire, et à vrai dire, comment y échapper dans ce monde fait de promesses et d’illusions finalement fort coûteuses ?
Dans cet essai, j’ai donc cru devoir dire que s’il y a un phénomène de désarroi social (Gilets jaunes et compagnie …), il vient malheureusement de ceux qui l’ont largement justifié.
La manière même dont – à l’occasion du fameux Covid – nous avons laissé traiter les morts – avec la bénédiction des « responsables » – en dit long ! Que, par souci d’efficacité hospitalière on en soit ainsi arrivé à faire disparaître des cadavres pour soi-disant éviter les contaminations et surtout faire de la place, nous montre ce à quoi conduisent les seules valeurs d’efficacité dans un monde plus matérialiste que celui-même de nos ancêtres les plus lointains.
Le matérialisme supposé bienveillant d’un Etat-machine compromet la République. C’est « Le temps qu’il fait ». Les instances dites spirituelles n’ont-elles pas participé elles-mêmes à cet effondrement moral ?
Mais « Le temps qu’il fait », c’est aussi celui du monde, comme tout autant celui de la personne, cet « individu » aujourd’hui fabriqué par une technocratie déshumanisée.
« Le temps qu’il fait », c’est aussi l’enchaînement des circonstances (toujours plus complexes qu’on ne veut bien le dire). Il permet enfin de projeter le Mal « hors de chez soi ». La Guerre s’avance masquée. Ce qu’elle occulte doit aussi être dénoncé. Car elle sert plusieurs causes à la fois. Et elle fait office de cache-misère, fût-ce même au nom des valeurs qu’elle est censée défendre. A cet égard aussi, la République passe par la liberté de parole. Nulle guerre n’est assez « juste » pour imposer d’emblée son discours à un peuple dont le sacrifice serait, par définition, le prix de son salut.
Exploration, analyse, proposition, « Le temps qu’il fait » dans notre République mérite d’urgence un juste combat. Plutôt que de donner des leçons aux autres, sans doute est-il urgent de balayer devant notre porte. Même la Psychanalyse dont j’ai tenté récemment de dire ma vision de poète ne saurait échapper à cette révolution. Qui ne bouge plus s’ankylose et meurt.
Il est donc temps que « Le temps qu’il fait » en appelle à de nouveaux et justes efforts. Il est temps que le respect de la personne – comme cela fut d’ailleurs dit après la dernière Guerre – l’emporte sur le « règne des CHOSES », à quoi, non seulement l’Economie, mais la Pensée dominante réduit les hommes du haut en bas de l’échelle sociale.
Enfin, hors des marchés en tout genres, la Poésie – au sens le plus large du mot – pourrait trouver sa place hors des rivalités comme le souffle de l’enfant qui naît, quand la Chose s’efface au bénéfice de la Personne.
24 juillet 2024
Ma vie de psychanalyste – De l’alliance au soin
La présentation du livre « Ma vie de psychanalyste – De l’alliance au soin » a donné lieu le 3 février dernier à une rencontre entre l’auteur et quelques dizaines de ses lecteurs. Cela s’est fait chez l’éditeur L’Harmattan (21bis rue des Ecoles- Paris 5ème). Le poète et philosophe Philippe Tancelin et Marie-Christine David auront fait suivre l’exposé de Jean-Pierre Bigeault de lectures du texte, l’ouverture de ce choix revenant à Philippe Tancelin, lui-même lisant le poème qu’il avait écrit précisément pour clore et même ouvrir « Ma vie de psychanalyste … »
L’interpénétration de la Poésie et de la Psychanalyse aura ainsi été posée comme fondamentale, rejoignant ainsi la pensée de Freud.
Captation Benoît Maréchal, Montage Dominique Morlotti
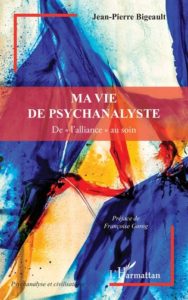 La psychanalyse est ce qu’en font les psychanalystes sur le terrain de la cure et de la psychothérapie comme dans leur vie. Entre la théorie et la pratique, s’ouvre le champ de la créativité d’un couple patient-psychanalyste, tel que le construit – en vue du soin – ce qu’il est convenu d’appeler « l’alliance thérapeutique ».
La psychanalyse est ce qu’en font les psychanalystes sur le terrain de la cure et de la psychothérapie comme dans leur vie. Entre la théorie et la pratique, s’ouvre le champ de la créativité d’un couple patient-psychanalyste, tel que le construit – en vue du soin – ce qu’il est convenu d’appeler « l’alliance thérapeutique ».
À la fin d’une vie d’éducateur puis de psychanalyste, Jean-Pierre Bigeault soutient que l’amour est au cœur du lien psychanalytique, l’« attention bienveillante » n’en étant que la partie visible. S’agissant « d’aide », la science ne tire profit de la distance que par l’engagement qu’elle appelle.
Jean-Pierre Bigeault
Préface de Françoise Gorog
Editions L’Harmattan, Novembre 2023 – Collection : Psychanalyse et civilisations
Commander le livre chez l’éditeur
Ulysse et compagnie …
Je me suis encore laissé embarquer dans mes réflexions sur Ulysse et en particulier son Odyssée. Cette obsession littéraire me poursuit et sans doute faut-il y voir, à l’heure où disparaît de notre culture le Grec ancien – auquel nous devons tant – une forme de nostalgie.
Mais en même temps, l’actualité du message envoyé par Homère, me surprend toujours. Par ces temps difficiles à tant d’égards, la pensée d’un poète aussi multiple me semble nous renvoyer à la sagesse grave et ludique dont nous manquons cruellement depuis tant de siècles.
Nos siècles en effet, tout aussi bien-pensants que trop souvent malfaisants, nous ont tourné la tête au nom de ce que les spécialistes de l’argent appellent aujourd’hui des « valeurs-refuge ».
Homère, le poète « nombreux », a compris bien avant nos rois et autres amateurs de gloire, le mensonge avéré des épopées toujours plus ou moins proposées pour le salut des peuples. Il n’est jamais trop tard pour écouter ceux qui, prenant la liberté de jouer avec la langue, prennent aussi celle de penser hors des sentiers battus. Et si l’on ajoute que l’œuvre d’Homère aura certainement été reprise et poursuivie par bien des poètes inconnus, réjouissons-nous que l’absence du Prix Goncourt n’ait pas trop pesé à l’époque sur la pensée !
Et moquons-nous de nous qui voyons notre République se faire manger la laine sur le dos par … des Cyclopes. Allons-nous attendre longtemps que la pensée serve ces faux-dieux ? Acceptons enfin l’idée que la Poésie (si peu vendable dans le monde que l’on nous fait) nous en apprenne plus sur l’humanité de l’Homme que la fausse science des technocrates et autres mangeurs d’hommes.
Ulysse et Athéna, et bien sûr Pénélope, font une armée du cœur et de la raison qui ouvre la belle Ithaque à une leçon d’humanité dont on aimerait que nos élites aujourd’hui s’inspirent.
Qu’on lise à tout le moins les derniers mots de l’Odyssée :
« Douce est la terre, aux naufragés dont Poséidon a fait sombrer les beaux navires en haute mer …peu d’entre eux peuvent échapper à la mer grise et nager vers le rivage : tout leur corps est ruisselant d’écume ; joyeux, ils mettent pied sur la rive, échappés au malheur …
Ainsi douce était pour elle la vue de son époux et ses bras blancs ne pouvaient s’arracher à ce cou … »
* *
*
Une pensée vient à l’homme presque plus ancien que lui-même – celui qui, à ma façon, regarde le monde qu’il s’apprête à quitter. N’y voit-il pas, au bout du chemin, ce qu’on pourrait appeler : « une fuite en avant » ?
Cette sorte de « Bateau ivre » n’est pourtant pas celui d’Ulysse, le célèbre naufragé retour de Troie. L’homme d’aujourd’hui n’est-il pas plutôt, comme l’aura dit Rimbaud, en son temps, « jeté dans l’air sans oiseau » ? N’est-il pas embarqué dans une Odyssée trompeuse ?
**
Car comment ne pas voir aujourd’hui le Monde comme il va, comme il est, y compris dans cette région où il brandit le drapeau de l’Homme jusque dans les guerres qu’il aura menées ici et là pour … le « sauver » ?
La course au profit, la réduction de la pensée politique à l’économie, la dislocation voire l’explosion sociale qui en résulte, ne sont-elles pas la suite d’une Histoire déjà marquée par l’instrumentalisation des peuples au service d’un totalitarisme ou d’un autre ?
Sous une forme apparemment moins autoritaire, il s’agit bien de la même opération : un « idéal » chasse l’autre. Qu’on passe d’une idéologie clairement affichée à une gestion technocratique, le traitement de l’Homme reste le même. Comme dans la guerre, l’Homme n’est qu’un moyen au service d’un « rêve » qui n’est d’abord qu’une ambition, voire – sans même en prendre la mesure – l’arme à peine consciente d’une vengeance plus ou moins infantile contre l’Homme et son Destin.
**
Le vrai Retour d’Ulysse – huit siècles avant notre ère – renvoie la guerre hautement symbolique de la Grèce aux illusions de la toute-puissance. C’est non seulement d’un retour à la Terre – représentée par Ithaque – qu’il s’agit, mais d’un retour à l’Homme et aux liens fondamentaux qui le constituent. Ainsi, quand Ulysse et son porcher Eumée se reconnaissent après tant d’années (vingt ans), ils sont les héros d’une rencontre de l’Homme avec lui-même. Ithaque n’est donc pas un rêve. Elle est, au terme du voyage, la Vie : Terre des hommes et des animaux (les fameux cochons), elle doit être reconquise contre les Prétendants, ceux-là mêmes qui, « vivant sur la bête » – comme on le dirait aujourd’hui – ne renvoient de l’Homme que l’image d’un faux ange déchu.
Ainsi le Retour d’Ulysse, son Odyssée, est-il la leçon que la Grèce la plus ancienne adresse à celle – la plus brillante – qui, trois siècles plus tard, va développer ensemble les deux attributs indissociables de l’être humain que sont l’intelligence et la sensibilité.
**
Et si nous entendions cette leçon ! Si en effet, aujourd’hui encore, l’Homme, aspirant à être ce qu’il est, revenait à lui et à ses semblables ? Quand les « choses » deviennent ce que, pour en tirer profit, on fait aujourd’hui du « climat », n’est-il pas temps de se réveiller ?
Car le « climat », c’est aussi l’esprit et le cœur de l’Homme. Qu’est donc le « malaise de notre civilisation » sinon qu’elle fait passer la matière la moins noble devant celle qui nourrit notre dignité de « chercheur de sens », notre espérance ici-bas ? Une spiritualité nouvelle se dessine au-dessus d’une Eglise qui s’est perdue dans sa toute-puissance ambigüe. Le vrai Retour est une recherche avant d’être un but.
Et sans doute, quand la charité porte le poids d’une injustice tranquillement instituée, le « partage » prend-il avec Ulysse le sens modeste d’un désir plus sensible qu’intellectuel. Ulysse, à cet égard, est celui qui fait signe, au-delà même de sa personne, à une « élite » qui ne fasse pas que courir après son ombre (narcissique) et l’argent.
Les chasseurs de trésor ont fait leur temps. Et si la République comme Ithaque, devait être reconquise ?
**
Encore le Retour d’aujourd’hui doit-il forger son propre mythe. Ulysse le naufragé, s’il ne prend notre visage, s’efface avec la littérature et la pauvre Grèce. Comme le portrait d’un autre, notre visage ne peut se voir dans ce miroir que comme celui d’un ange encore assez moqueur. N’est-il pas la figure de notre esprit, une fois dégagée de tant de croyances où l’embarquent ses protecteurs ? Nos « maîtres » – faut-il le dire – sont à réinventer. Puissent-ils, comme les dieux grecs, s’affranchir d’un ordre trop établi pour n’occuper avec nous que la place d’un Destin dont nous partageons la maîtrise.
Ou bien cette République s’en remet à d’autres forces que les siennes, telle Ithaque livrée à la seule concurrence de ceux que l’on sait. Ou bien le retour à l’Humanité de l’Homme, ou le jeu de la Chose courant après les choses, tel est notre choix.
Jean-Pierre Bigeault,
4 Septembre 2023
Identité(s)
On peut se demander si certains questionnements actuels qui étonnent, voire font scandale, ne seraient pas les marques de la Société qui les produit.
Pour ce qui concerne en particulier « l’identité sexuelle » et la « colonisation », il s’agit – comme on le sait – de dénoncer les effets d’une violence sous-estimée voire déniée. Tout se passe comme si notre culture, pourtant soucieuse de clarté, s’arrangeait pour laisser dans l’ombre certaines questions touchant à la liberté des personnes et des sociétés.
Or, ces questions, si fondées soient-elles, ne méritent-elles pas d’être replacées tout aussi bien dans le contexte qui, aujourd’hui, les éclaire pour ainsi dire au-delà même des problèmes qu’elles soulèvent ? Autrement dit, ne doit-on pas les comprendre comme les effets d’une violence actuelle tout aussi déniée que celles qui l’ont précédée ?
S’il ne s’agit pas d’évacuer les problèmes aujourd’hui posés, ne devons-nous pas en tirer profit pour voir à travers eux – et qu’il s’agisse en effet d’identité et de colonisation – la réalité actuelle, qui, pour le moins, les inspire ? Ainsi, quelque réponse qu’on entende donner à ces questions, on pourra tout au moins, à travers elles, prendre la mesure du vaste problème politique qui en rend aujourd’hui l’expression non seulement possible mais nécessaire.
1 – Quelque complexe qu’elle soit – et souvent difficile à traiter concrètement – l’identité sexuelle pose la question primordiale de l’identité, tant dans le champ personnel que le champ social. La réalité sexuelle ayant pris dans notre culture la place que l’on sait, le problème aujourd’hui soulevé est celui du rapport de chacun avec l’image identitaire qu’à ce titre il a de lui-même. Il s’agit là – à n’en pas douter – d’un problème qu’on aurait tort de simplifier. Il exprime une réalité nouvelle : la personne n’est pas réductible aux signes extérieurs de son identité. Elle est d’abord ce qu’elle vit d’elle-même dans son « for intérieur ».
Qu’on le veuille ou non, c’est donc bien d’une forme instituée de violence actuelle qu’émerge, à travers la spécificité sexuelle, la question post-moderne de l’identité. La société contemporaine en est le théâtre et, d’une certaine manière, la justification. Ouverte à la culture du « développement personnel », elle obéit à un « ordre » dit et non-dit qui l’enferme. Ce nouvel ordre prend forme dans le double développement d’une technocratie et d’un « économisme » centré sur la consommation. Une rationalisation sert de couverture à cette emprise.
Dans un tel contexte, le « sujet » individuel – la personne entendue comme la référence psychopolitique – se perd dans une profusion symbolique et bien réelle de « choses » (théoriques et concrètes) qui l’aliènent au prétexte de l’aider à vivre. La vie en effet, qu’elle soit individuelle ou sociale, s’y perd comme dans un désert. La fameuse « communication » y prend d’ailleurs l’allure fantomatique d’une signalisation à la fois décharnée et compulsive.
Une telle violence – banalisée à souhait – se distingue à peine de l’agitation plus ou moins passive d’une société embrigadée dans un rêve sans perspective. Elle n’en attaque pas moins l’identité même des personnes, et, par là même justifie, dans leur principe, les questions qui nous intéressent ici.
2 – Il n’est d’ailleurs pas sans intérêt à cet égard de rapprocher cette crise de l’identité subjective de la demande actuelle de réparation historique concernant la colonisation.
En tant que « destruction de cultures », la colonisation peut être assimilée à une attaque contre une identité collective. Elle joue par là même le rôle d’une entreprise d’aliénation. Le fameux « progrès « – fût-il religieux – qui aura servi de prétexte à cette violence ne fait que dissimuler, sous de « belles intentions », la négation mortifère dont il est le support.
La prise de conscience de telles réalités est aussi nécessaire que la décolonisation elle-même. Elle doit permettre de prendre la mesure d’une violence politique telle qu’elle fonctionne encore et toujours, y compris aujourd’hui, dans une culture comme la nôtre. Car la « violence au nom du Progrès » repose sur un modèle qui traverse tous les Pouvoirs. Le cache sexe d’une démocratie ne saurait le faire oublier. Ainsi, le refus de voir le ressort et le rebond d’une violence historique évidente apparaît pour ce qu’il est, y compris sous les aspects lénifiants d’une culture bien-pensante comme la nôtre.
On doit donc le voir : la vaste question de l’aliénation des personnes et des peuples sous le masque des « bonnes intentions » justifie que la colonisation soit démontée dans son principe.
Notre réalité socio politique, nos moyens d’analyse, nous mettent en demeure de nous interroger politiquement sur notre histoire pour en tirer les leçons qui s’imposent. N’est-ce pas d’ailleurs le droit et le devoir d’une démocratie qui ne craint pas de s’offrir en modèle, alors que ses dérives peuvent aussi bien, d’un jour à l’autre, devenir la norme d’un Pouvoir supposé plus efficace ?
Il s’agit en tout cas de prendre la mesure du « Système » à la fois technocratique, économique et conceptuel qui ordonne aujourd’hui notre vie individuelle et sociale. Il fonctionne selon des schémas qui échappent à la maîtrise voire à la conscience de chacun. C’est donc là, qu’on le veuille ou non, une forme spécifique de violence dont les éventuels effets positifs tendent à effacer la force négative. L’image identitaire que se font d’eux-mêmes les bénéficiaires supposés dudit Système est attaquée par la pression qu’exerce sur eux l’image anonyme et quasi télécommandée qu’on leur impose. Conscientisée ou non, cette réalité tend à se substituer aux spécificités culturelles et personnelles. On comprend que, dans un tel contexte, la revendication identitaire prenne le pas – plus ou moins clairement – sur l’adhésion aux « modèles établis ». L’intimité de chacun doit se défendre contre une forme de normalisation inévitablement ressentie comme agressive.
On peut enfin se demander si, dans le contexte des évènements évoqués ci-dessus – et, plus largement à travers les récents troubles sociaux (Gilets jaunes compris) – le sentiment d’« aliénation » n’a pas gagné une large partie des citoyens. Entre la colère et la dépression des électeurs qui votent de moins en moins, on aperçoit la défiance d’un peuple dont les représentants ne proposent aucun projet digne de ce nom. La « gestion », elle-même discutable, a tout envahi. Quelle espérance républicaine entre les mots creux et les mesures d’urgence ? Quelle identité démocratique dans cette « royauté » surplombante et nue comme autrefois Noë ?
Jean-Pierre Bigeault
Août 2023
L’émeute
L’émeute – comme son nom l’indique – est une « émotion collective » qui emporte tout sur son passage. Elle ne tombe pas du ciel mais elle vient de bien plus loin que ce qu’on appelle une « manifestation ».
Et pourtant l’émeute rend aussi bien manifeste ce qui était caché, ce qu’on ne voyait pas ou ne voulait pas voir. Elle montre ce qui semble s’échapper violemment d’une terre réputée instable et dont explose soudainement la lave d’un volcan qu’on croyait ou voulait croire endormi. Telle est donc la réalité de l’émeute : elle couve et on l’oublie. Quand elle éclate, sa violence est diabolisée.
Il est vrai que l’émeute dépasse même celles et ceux qu’elle emporte dans un mouvement destructeur qui fascine tout le monde. La folie semble y côtoyer la froide détermination. On aurait tort de la réduire – comme on est tenté de le faire pour s’en protéger – à quelque explosion fortuite ou exclusivement explicable par l’incident – si grave soit-il – qui la déclenche. L’émeute, par sa violence, donne à voir ce que nos ancêtres pouvaient assimiler à la colère des dieux, fussent-ils, comme on le dira, de simples voyous ! L’émeute est une guerre qui ne dit pas son nom.
On doit pourtant tenter de la comprendre. C’est à cette seule condition qu’on peut en effet espérer qu’elle ne débouche pas sur un conflit beaucoup plus grave. Car il y a une rationalité dans l’émeute. On peut et doit la voir comme le symptôme d’une tension qui ne trouve d’issue que dans ce que les psychologues appellent le « passage à l’acte ». A ce titre, on est loin de ce qu’on désigne à l’Ecole comme une « indiscipline ». La puissance de l’explosion qui en résulte
dénonce une souffrance psychosociale voire une maladie grave. De ce point de vue, l’émeute doit être regardée pour ce qu’elle « signifie » : sa forme n’est pas un accident. Elle donne à voir le noyau caché de son fruit amer. Que l’émeute se vide en effet comme un abcès ne dit pas tout. Une vraie maladie est à l’œuvre sous l’amas de colère qu’exprime en effet l’émeute. Ainsi – dans le cas qui nous occupe – ce que « sont » les émeutiers est aussi significatif que ce qu’ils « font ». Ils détruisent, non seulement les symboles, mais des biens qui participent de leur vie quotidienne. A quoi jouent-ils donc ces jeunes boutefeus ?
Pour peu qu’on ait quelqu’idée sur la psychologie des adolescents, un tel comportement porte un nom : il est auto destructeur, c’est-à-dire suicidaire. Telle est la réalité. Quelque dramatiques que soient les conséquences de cette « maladie », faut-il encore la regarder pour ce qu’elle est dans sa spécificité. La dimension politique de l’émeute, non seulement ne disparaît pas dans cette interprétation, mais elle y prend au contraire le caractère dramatique d’une révolution qui semble d’abord se condamner elle-même. Le désespoir guette aux portes de ce qui, sous la violence, se présente aussi bien comme une dépression.
C’est bien par là que la République est intimement menacée ! Car le sens de cette « guerre » doit être compris. La « maladie » s’y découvre au-delà de la supposée violence endémique. Le plaisir n’est pas tant d’en finir avec la République qu’avec le monde qui l’incarne et avec soi. La maladie de ces « grands enfants » a pris le tour d’une autodestruction. Ils s’attaquent à « leur » cité, à ses institutions, à ses commerces ; ils scient la branche sur laquelle ils sont eux-mêmes assis, car pour eux, cette branche est pourrie. Aussi bien, la mèche est-elle allumée depuis longtemps. Elle fait partie du décor. L’émeute procède d’une destruction depuis longtemps en cours. Elle passe de l’objet au Sujet et le Sujet se perd lui-même dans la désolation des ruines. Que l’Etat anonyme ou cette Machine identifiée à la Police devienne mécanique, cela ne fait aucun doute, mais les émeutiers vont bel et bien pourtant se punir eux-mêmes. La Messe est dite. S’il ne reste donc qu’à punir les victimes, c’est qu’en tant qu’émeutiers ils donnent à voir précisément l’ampleur du désordre : on efface le drame au profit d’un problème. Car la complexité dérange dans un monde où, qu’on le dise comme on voudra, il y a les « bons » et les « méchants », les « bons élèves » et les « mauvais ».
La maladie vient certes de loin. L’émeute n’est pas par hasard un spectacle. Elle manifeste ce qui est dans la conscience voire l’inconscient de ses acteurs. S’agissant de la dernière en date, elle donne au meurtre d’un jeune par la Police le sens d’un cataclysme aussi hautement symbolique que l’assassinat d’un Prince à l’origine de la première guerre mondiale.
La maladie vient certes de loin. Quand on dit et répète à l’envi que, sur tel ou tel « territoire », les lois de la République sont bafouées, oublie-t-on que la Drogue y exerce depuis longtemps et aux yeux de tous, le vrai pouvoir ? Et cela bien sûr, malgré les « contrôles d’identité » ! Tout se passe donc comme si, non seulement l’impunité, mais la mort, pouvaient s’installer « hors les murs » de la République, dans des zones dédiées à l’illégalité. Est-ce donc là inconscience, impuissance, ou complicité ? Un Etat qui, dit-on, dépense tant d’argent pour sauver ce qui ne pourrait l’être, paie-t-il donc le prix d’une Faute qui lui revient, alors même qu’il la fait porter par ses propres victimes ? Cette question peut et doit être posée.
Mais nos jeunes émeutiers souffrent aussi d’une misère qu’on ne veut pas voir davantage. L’Ecole de la République a beau faire, elle ne supplée pas à des « manques » qui dépassent de loin la scolarité. Ces adolescents en effet, ne bénéficient guère des « figures d’identification » nécessaires à leur développement. Les parents subissent la dévaluation sociale des « laissés pour compte ». Dans une « culture » dominée par la réussite matérielle, ils font figure de « perdants ». Quand les élites d’une telle société n’ont toujours rien compris à la problématique spécifique de l’adolescence et font appel à l’autorité comme à la solution miracle, c’est qu’elles nient tout ce que savent les éducateurs … depuis longtemps ! Depuis bien avant 68 et le pédagogisme de quelques apprentis sorciers.
De sorte que l’appel à la responsabilité des parents n’est qu’un cautère sur une jambe de bois. Il tourne le dos à cette réalité qu’on ne veut pas voir : l’autorité ne tombe pas du ciel. Comme d’ailleurs aussi bien à l’Ecole elle-même, elle repose sur une qualité spécifique de ceux qui l’exercent. Les parents – comme d’ailleurs les professeurs – n’échappent pas à cette règle : s’ils permettent aux adolescents de mûrir (et donc d’apprendre) c’est d’abord par ce qu’ils sont et re-présentent. Le Savoir (comme d’ailleurs l’argent) n’y jouent pas le rôle exclusif qu’on veut lui donner. Comme on a pu dire qu’« au feu le vernis craque », il n’est que de regarder certains représentants de la République pour voir que leur « présence » n’est pas au rendez-vous de leur fonction : la confiance repose sur des valeurs authentiques incarnées par de vraies personnes (et non des intelligences artificielles déguisées en hommes). A défaut, c’est le doute qui l’emporte, y compris d’ailleurs chez les adultes que nous sommes.
Les adolescents violents d’aujourd’hui crient partout le manque dont nous souffrons tous et dont ils souffrent doublement. Quant aux « territoires » en perdition, ils en appellent à des moyens qui ne sont pas que financiers. Ils devraient nous sensibiliser au vaste problème de l’éducation, réduite aujourd’hui à l’instruction : l’avenir de la République et des citoyens en dépend. Le Développement comme le « Progrès » ne seront bénéfiques aux personnes que si les personnes sont traitées comme telles par des personnes véritablement reconnues.
Ce grave problème, déjà sensible hors des banlieues, n’est pas systématiquement réductible – comme on tente de le faire – à des troubles relevant aujourd’hui de la Psychiatrie et des traitements médicamenteux. Il relève d’abord de l’Education et, à ce titre, justifie l’existence de moyens en personnes et institutions adaptées. Si l’Ecole veut y pourvoir – et elle le peut à certaines conditions – il lui faut se repenser au bénéfice de tous : « égalité des chances » si l’on veut, mais d’abord des moyens éducatifs. La connaissance et la conscience que nous pouvons avoir aujourd’hui de la problématique psycho éducative propre à l’adolescence doit en effet nous permettre d’associer l’Education à l’Instruction.
Si nous ne le faisons pas, si nous continuons d’en référer utopiquement comme à un dieu sauveur, appelé « autorité disciplinaire », nous achèverons les adolescents les plus prometteurs qui sont souvent les plus fragiles au profit de petits « maîtres » fantoches que nous voyons à l’œuvre tous les jours. Il s’agit donc d’un choix de société, d’un choix politique. On peut enfermer la violence dans un infantilisme totalitaire tel que ce fut le cas pour la jeunesse nazie, il reste stupide d’opposer une éducation permissive à une autre qui ne le serait pas. La véritable autorité, celle qui contribue à l’éducation, est une construction plus intelligente et plus sensible que ces raccourcis de café du commerce. Elle fait appel, y compris chez les enseignants, à des qualités spécifiques et qui, pour ne pas être prises en compte dans la sélection, ne sont que livrées au hasard. Il est urgent de se souvenir que nos meilleurs maîtres ont été celles et ceux qui, pour nous accoucher de nous-mêmes, ont associé la sensibilité à la rigueur. Ce mélange fait appel – y compris dans l’enseignement – à des éducateurs.
Les études, les expériences, ont existé – voire existent encore – mais comme je l’ai constaté moi-même dans les Colloques organisés par l’Education Nationale sur « l’échec scolaire » (où j’étais invité en tant que spécialiste), on aura toujours tout fait pour noyer le poisson. Le comble du ridicule aura sans doute été la conclusion apportée par un Ministre de l’Education nationale à nos travaux : penser à l’ergonomie, la qualité des sièges, etc. …
Quand on sait que « l’échec scolaire » relève d’une éducation appropriée, cela donne la mesure de l’abîme que traversent aujourd’hui si allègrement, les maîtres à penser d’une Réforme autoritaire ou « ergonomie morale ».
Pour avoir suivi moi-même, enseigné, éduqué et soigné, pendant trente ans, des adolescents et des adolescents en difficulté, je suis en mesure d’affirmer que l’adolescence aujourd’hui demande un renouvellement de la pensée et de l’action éducative.
Jean-Pierre Bigeault,
Ancien professeur de Lettres,
Ancien créateur et responsable d’Institutions psychopédagogiques
et psychothérapeutiques pour enfants et adolescents.
Juillet 2023