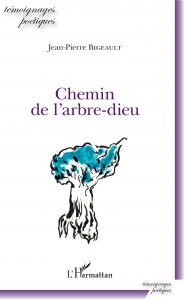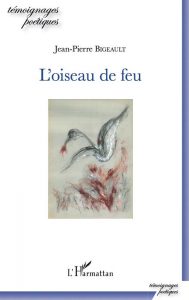D’une angoisse
D’une angoisse …
…qui n’est pas la peur
Nous avons peur et nous sommes angoissés. D’un côté un ennemi invisible mais « nommé », contre lequel une « guerre » (c’est le mot officiel) doit être déclenchée ; de l’autre, une situation confuse de menace mélangée d’un vague espoir, l’idée d’un changement radical se dessinant au milieu des ruines attendues.
L’exploitation politique du danger réel – le Pouvoir se dérobant devant l’Angoisse – semble une évidence. Les guerres, on le sait, sont supposées faire taire les dissensions internes au nom de « l’union sacrée ». Illusion certes coûteuse. L’adhésion à l’ordre de la guerre est une obligation morale. On fusille les dissidents. Les héros sont consacrés, oriflammes souvent pathétiques ! Derrière ces opérations et au fond des consciences, voire des inconscients, l’angoisse se terre. Elle constitue un socle sablonneux qui défie l’idée de construction. C’est un amas de souvenirs et de sentiments qui se dérobent tout en pesant leur poids. En attendant – la Victoire et la Paix – il faut « tenir », se tenir, serrer les poings, les dents, se serrer les coudes et la ceinture, serrer les rangs ! L’angoisse, malaise qu’on assimile à un étranglement, se retourne en cette « prise en main » de soi-même, contrôle quasi musculaire d’une vie qui, laissée à elle-même, se déroberait sans doute.1
Les guerres remettent un peu d’ordre dans la boutique !
Là ou le Terrorisme n’aura provoqué qu’une « union sacrée » émotionnelle plus ou moins passagère, un virus, chez nous, ferait-il l’affaire ?
Dans la mesure où l’angoisse déborde les peurs identifiables – s’articulant elle-même avec ces « crises » de tous ordres et qui mettent en cause les « systèmes établis » – on peut douter que la victoire relative sur un ennemi identifié suffise à calmer les esprits. La « montée de la violence » contre les inégalités (gilets jaunes) dit un trouble profond dans lequel les trois-quarts d’un peuple se sont plus ou moins reconnus. L’éclatement du tissu social d’un côté, et de l’autre, l’incertitude commune sur les évolutions en cours, le caractère menaçant de ces évolutions, l’absence de référence, un véritable progrès humain, le culte du profit aux dépends non seulement de la Justice mais de la Vie, la médiocrité d’une élite technocratique et d’une classe politique coupées du vécu réel sont les éléments constitutifs les plus clairs de cette angoisse.
Que les « représentants » du peuple ne soient pas à la hauteur n’est certes pas une nouveauté et il n’est pas dit que le procès qu’on fait à leur moralité ne vise pas surtout leur absence de génie. Ce qui, du génie de De Gaulle aura survécu à l’œuvre même – bien évidemment contrastée – appartient à sa personnalité, sans doute plus qu’à ses idées. L’autorité nécessaire d’un chef repose sur son authenticité. Nos gouvernants, quelque doués qu’éventuellement ils soient, en manquent cruellement.
Mais ces déficits ne suffisent pas en tant que tels à expliquer l’angoisse. Ils ouvrent devant eux le gouffre que représente l’avenir : l’avenir de la Planète, l’avenir de la France, l’avenir de chacun. Le Monde fait en effet plus que peur : « Rome n’est plus dans Rome ». La nécessité d’un changement de perspective (en particulier de Développement) s’impose et nul doute qu’il exigera de toutes façons des sacrifices. Vers quel monde, vers quelle société, vers quelle vie personnelle pouvons-nous aller, et comment ? Le vertige de la « révolution » quels que soient sa forme et son contenu, s’impose à l’esprit de beaucoup, sinon de tous. Nul n’en voit se construire une élaboration si peu que ce soit rassurante : un projet. « Du bruit et de la fureur » ou des utopies, mais comment donner corps au « monde nouveau » ?
L’angoisse ne nourrit de cette incertitude. Elle ré édite, selon Freud, l’expérience traumatique de la naissance. Comment passer d’une enveloppe connue à cet espace physique et cette culture également inconnus d’après toute naissance ?
Notre liberté de l’imaginer – produit pour une part de notre expérience démocratique – nous met à l’épreuve. Comment avoir les moyens de cette liberté ? S’il est un paradoxe, c’est qu’en effet « l’espoir » lui-même nourrit l’angoisse. Plutôt donc qu’éliminer ce fardeau ambigu (et Dieu sait que la Consommation nous offre les moyens de le faire), il nous faut l’apprivoiser en lui donnant forme. C’est ce que tente de faire le psychanalyste et poète qui signe ce propos. Un chemin dans le soi et le partage avec d’autres nous sont aussi nécessaires que le jeu avec le monde et ses objets – tel le langage – qui sont aussi notre tissu vivant.
Jean-Pierre Bigeault,
Le 8 mars 2020
1 On voit bien sûr ici le rôle anxiolytique des dictatures ou assimilés.