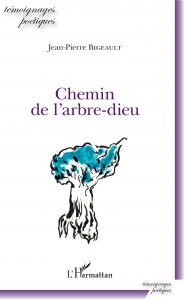Grand Inquisiteur
Enfin le Grand Inquisiteur est arrivé ! Il s’appelle Mr. STOP COVID (on trouvera son vrai nom dans le Magazine du Monde du 23 mai et aussi quelques éléments biographiques).
Ce technocrate chrétien, socialiste aujourd’hui « libéral », semble bien un pur produit du Système, tel que nous le voyons à l’œuvre dans un pays à cet égard depuis longtemps « macronisé ». Rien que de très banal ! Mais enfin ce technocrate parle ! Il dit (toujours selon Le Monde) dans une Tribune publiée sur le site Médium : « chacun pourra refuser cette application1 pour des raisons philosophiques », mais cela reviendra « à accepter le risque de morts supplémentaires ». Le choix est donc clair : renoncer au respect de sa liberté (valeur démocratique par excellence) ou devenir potentiellement un assassin.
L’idée que les citoyens disposent encore d’un sens de la responsabilité étant évacuée par principe, on se demande pourquoi ces mêmes citoyens ont encore le droit de voter ! On appréciera par ailleurs le déplacement de l’ordre politique sur l’ordre moral.
Ainsi, la bonne vieille culpabilisation, nourrie de la peur, est-elle appelée à l’aide, quand on ne sait plus quoi faire, ou plutôt, tout aussi bien, quand on y trouve avantage en matière de pouvoir. Un plan d’urgence pour une éducation citoyenne dès l’école n’étant pas au programme, on voit à quelles vieilles recettes – dignes de Vichy – nous ramène la technocratie et sa culture a-morale des résultats.
Qu’on se le dise une fois pour toutes : l’homme est mauvais par définition (sauf lorsqu’il gagne beaucoup d’argent puisqu’il fait tourner la Machine) et il faut encore une fois le « sauver » – autrement dit, le « surveiller et punir », fût-ce en recourant à une police des mœurs.
A bon entendeur, salut !
Jean-Pierre Bigeault,
Le 23 mai 2020