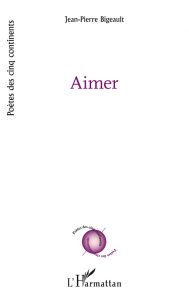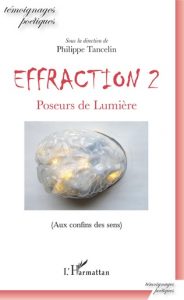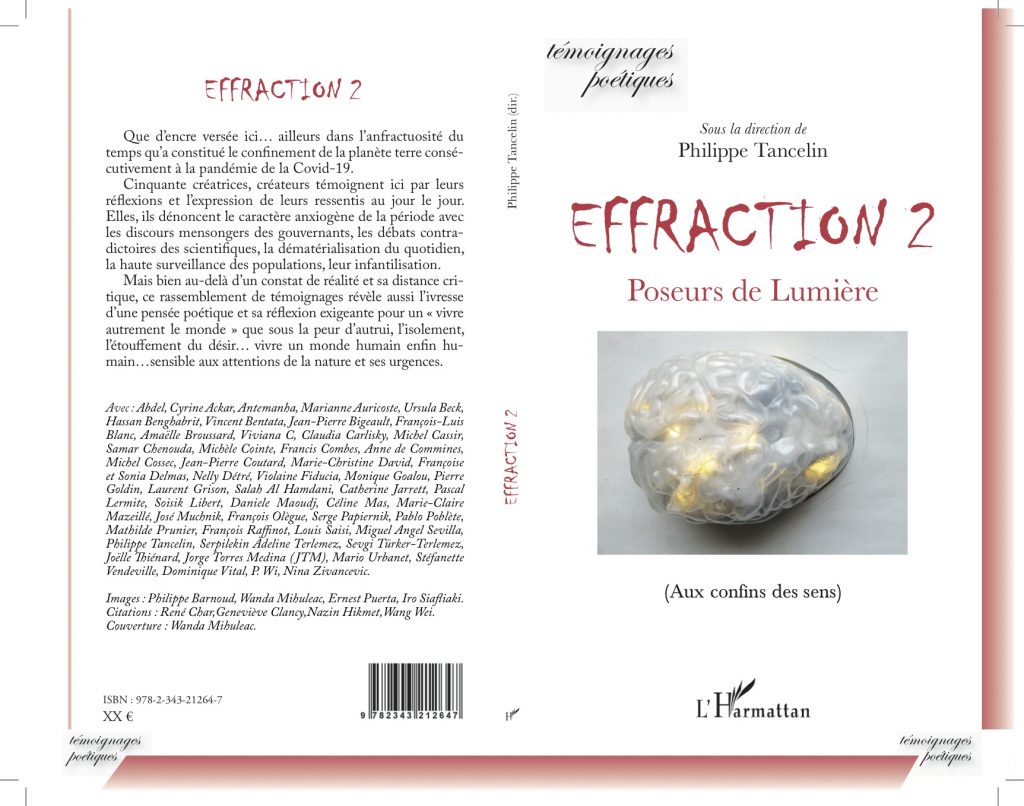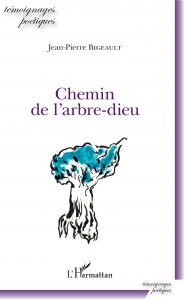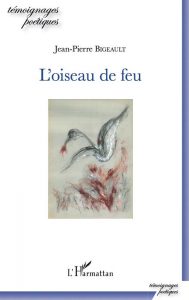NOTRE CHEMIN
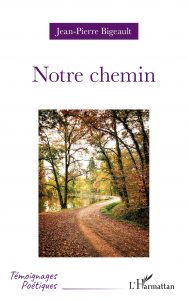
Notre chemin
Qu’est-ce que l’Amour ? La Poésie seule peut aider la Pensée à s’approcher d’une réalité qui nous associe à celle du Monde. Car l’Amour n’est pas un acte sorti de la Vie mais la Vie reprenant ses droits jusque sur notre Pensée, en tout cas lorsque celle-ci s’avise à découper la réalité en tranches.
L'Harmattan - Témoignages poétiques - 2025
Cliquer ici pour commander le livre sur le site de l'éditeur
Notre chemin
Présentation du 24 mai 2025
Librairie L’Harmattatn
21bis, rue des Ecoles
75005 – Paris
**
Toute petite introduction en forme de poème de – et lu par Jean-Pierre
Poésie
du même geste que l’Amour
c’est le corps
non l’esprit sé paré de la chair
mais l’unité perdue retrouvée
de ce qui fait à l’Homme
son bonheur de passer par le monde
en cherchant ce qui pourrait être
fût-ce au-delà de soi
le chemin.
*
Marie-Christine prend la parole
C’est donc moi, Marie-Christine, son épouse, et en tant que destinataire de l’ouvrage, que Jean-Pierre a chargé de présenter aujourd’hui son livre. Il a pour titre : « Notre chemin ». C’est une suite de poèmes et de réflexions, non seulement sur l’Amour, mais sur celui que je vis depuis plus de 32 ans, avec mon poète.
Jean-Pierre a intitulé ce livre « Notre chemin » pour dire de l’Amour qu’il est à la fois une « voie » qui permet d’aller d’un lieu à un autre » et, comme le dit encore Le Robert : « la bande de terre assez étroite qui suit les accidents de terrain ».
Le choix de ce nom « chemin » fait aussi allusion aux chemins que nous avons suivis l’un et l’autre, lorsque nous étions enfants, et cela à 27 ans de distance et dans des régions bien différentes, puisqu’il s’agit du Bourbonnais (Nord de l’Auvergne), pour moi, et pour lui, de la Normandie. Montagnes donc d’un côté, et de l’autre, bocage et mer. Sous l’évidence des différences de temps et d’espace, il arrive donc que l’Amour réunisse des affinités moins claires. En ce sens-là, le Chemin traverse des époques et des contrées qui se parlent entre elles dans une langue pourtant commune.
Car ce Chemin est à la fois une voie et un parcours. Ni grand route, ni sentier, il est « tracé dans la terre sous la forme d’une bande assez étroite, à la fois suffisamment déblayée et capable de suivre les accidents de terrain.
A ce titre, le livre dont il est ici question raconte, à sa façon, un chemin où les images, les idées et les sentiments se composent entre eux selon des « points de vue » - ces points qui font par exemple du Chemin de la Hague, tout en haut du Cotentin, une sorte d’observatoire en marche.
Cela donne 6 chapitres qui s’énoncent ainsi :
Dans la vallée
Gravité de l’innocence repêchée
Recueillement des signes
L’amour n’en finit pas de commencer
L’amour contre la culture
Quelqu’un vient
Poèmes, récit, essai, ce livre ressortirait plutôt à ce qu’on appelait autrefois un « mélange ». N’est-ce pas le propre de tout vrai chemin, que de prendre successivement la forme et les traits du paysage qu’il traverse ? Et n’est-ce pas aussi bien le propre du chemin puisqu’à la fois nous le faisons et qu’il nous fait ?
Cependant, « Notre chemin » est aussi clairement marqué par le caractère inévitablement « passager » de son parcours. De par notre différence d’âge, il est confronté plus clairement que tout autre à la séparation de la Mort. Mais cette confrontation pourrait aussi bien être essentielle. Car l’Amour a toujours plus ou moins à faire avec la Mort. Les deux mots latins « amor » et « mors » sont là pour le dire. L’Homme n’a pas attendu le Romantisme pour associer le chant de l’un et le silence de l’autre. « Notre chemin » affronte l’idée de séparation-bifurcation, comme sa réalité. Il ne permet pas de l’escamoter.
Tout cela ensemble met le parcours devant sa limite. Il y a une peur, fût-ce au fond du Bonheur, et, en même temps, comme le dit Sophocle : « une timide espérance ».
Cela fait donc un « chemin » tel que sans doute autrefois, celui, qu’enfants, nous suivions dans la campagne. N’allions-nous pas déjà à la recherche d’une vérité du monde qui se cachait, pour l’une, dans la montagne, et pour l’autre, dans les prairies ? Qu’y avait-il au bout de ces chemins, sinon une vérité de solitude et de partage ?
Un Amour dessine ainsi la Vie comme le Chemin d’une voie dont l’aboutissement nous échappe en ce sens que la Mort ouvre à la fois sur une sorte de Tout et de Rien. Ce « chemin » – parmi d’autres – nous fait. Aimer quelqu’un d’autre que soi, n’est-ce pas déjà faire un saut dans l’inconnu ? Et cela s’apprend. L’idée du « chemin » donne à ce saut le temps d’une durée : écrire un poème n’est-il pas renoncer à soi pour adhérer à un partage avec l’inconnu, et po rtant ce partage tout aussi bien nous agrandit ?
Ce li re s’en tient à l’idée d’une Source perdue au loin dans la montagne, et qu’il s’agit de retrouver. L’Amour est une deuxième naissance. Et que ce soit sous cette forme ou une autre, l’Homme a besoin d’une deuxième naissance.
Comme l’Amour, un livre est un « chemin » qui reste à faire et peut-être même au-delà de ce qu’il aura été, sous une forme imprévisible, tel un poème qui reste toujours à écrire.
**
Jean-Pierre reprend la parole
Quoique je ne sache pas très bien si c’est pour compléter ou commenter le texte de mon livre intitulé « Notre chemin », je voudrais vous dire quelques mots sur le fait que l’Amour, comme d’ailleurs la Poésie, passe par le corps. Et cela n’est pas aussi simple qu’il y paraît !
Les mots et les gestes font en effet l’enveloppe matérielle de l’Amour et même bien davantage. S’ils passent les uns et les autres par le corps, ils font pourtant plus que ce qu’on s’applique à réduire en faisant sortir la sexualité du contexte dans lequel elle peut s’inscrire pour soutenir cette véritable création qu’on appelle « l’Amour ».
Autant dire que le « faire l’amour » et « l’aimer », peuvent coïncider. Car sans doute faut-il ici le rappeler – quelque malaise que notre Culture ait développé à ce sujet : quand, pour ainsi dire, « faire l’amour » et « aimer » coïncident, il faut bien dire que la spécificité de l’amour humain participe d’une forme d’ouverture à la Vie sans doute incomparable à aucune autre.
Une telle idée n’a pas grand-chose à voir avec ce que, dans ma jeunesse, on a cru bon d’appeler : « la libération sexuelle ». Interrogée d’ailleurs aujourd’hui au titre des abus commis en son nom, la sexualité semble bien de nouveau poser problème.
En effet, l’espèce de « réduction objective » à laquelle on a soumis la sexualité – y compris d’ailleurs au nom de la Psychanalyse – en en faisant une sorte d’appareil doté d’un fonctionnement propre n’aura sans doute fait trop souvent que brouiller les cartes. Faut-il ajouter que cette « objectivation » s’est elle-même inscrite dans une culture de la consommation qui commence d’ailleurs, comme on dit, à « perdre la boule ».
Or l’Amour du fameux « faire l’amour » en appelle à une créativité pour ainsi dire méta technique : elle passe par une extension du désir physique à un mouvement d’ouverture à l’autre qui lui donne son caractère spécifiquement humain. Encore ne s’agit-il pas là de charité ! Et je pense davantage à ce que le poète Rilke appelait précisément « l’ouvert ». En ce sens « faire l’amour » n’est pas se retirer sur soi, mais passer par-dessus soi pour rejoindre le Monde. Prière du corps, pourrait-on dire, à celui que Steinbeck appelait « un Dieu inconnu ».
S’il est un chemin, l’Amour est donc aussi un voyage. Il s’avance dans une terre exotique et même si étrangère que, par paradoxe, on l ’appelle « intimité ». A ce titre, on pourrait dire que l’Amour – comme on le voit dans le mystérieux tableau de la Joconde – serait comme un pont, un chemin, qui tente de sauter par-dessus la vallée, pour rejoindre le ciel. C’est que l’assez mal vue animalité de l’Homme s’inscrit en effet dans une histoire et une dynamique particulière. Celle-ci tient, chez l’être humain, aux conditions de sa naissance. L’Homme naît en effet plus ou moins prématuré, c’est-à-dire en tout cas « inachevé ». Et cet inachèvement qui justifie son éducation constitue le manque initial sur lequel vont se fonder tant le désir de connaître que celui d’aimer et d’être aimé.
Notre culture judéo-chrétienne n’a-t-elle pas d’ailleurs désigné ce « manque » initial dans l’image et le nom même de « Paradis perdu » ? On pourrait dire de ce point de vue que l’Amour – y compris sous son aspect physique – s’offre à l’Homme comme une religion primordiale. La sexualité servant alors, dans ce contexte, un dieu que les anciens Grecs n’avaient pas peur de nommer (Eros).
De ce point de vue, on peut dire que la sexualité humaine apparaît comme le comblement d’un vide. Elle répond à un besoin de compensation qui, chez l’être humain, touche à son existence même. Mais il n’en reste pas moins que le plaisir sexuel, au plus fort de sa force, conjugue à la fois un certain sentiment de puissance et un autre de dépendance. Le plaisir spécifique appelé autrefois « petite mort » dit bien ce qu’il dit : il y a une perte de soi concomitante à la jouissance, et, par là même, on peut parler d’une certaine ambiguïté de l’Amour. Mais n’est-ce pas celle aussi de la Vie ?
Ces idées que j’ai cru devoir vous communiquer font référence à une théorie connue sous le nom de « néoténie ». Elle nous permet de reconsidérer l’Amour comme d’ailleurs la Connaissance, sous leur aspect réparateur. On est certes loin de la réparation plus ou moins sacrificielle rapportée à une « Faute originelle ». La « Faute » ici n’est qu’un manque, et elle n’est « originelle » que par rapport au déroulé même de toute naissance humaine. De ce point de vue, l’Amour humain n’a pas à plaider coupable. La méfiance dont il fait l’objet dans une idéologie, voire une morale de la séparation du Corps et de l’Esprit ou « Âme », peut être ici dénoncé. Notre monde a mieux à faire : il peut et doit réinventer l’Amour le plus banal comme un chemin vers sa vérité.
Chemin modeste et qui se garde bien de projeter le manque d’où il procède sur une théorie de la « Faute » au sens moral de ce mot. L’Amour n’est pas seulement une récréation, il est une création. Il est une œuvre qui se fait, qui se confronte à la mortalité jusqu’à en accepter la limite. A l’âge où j’aurai écrit ce livre (Notre chemin), la rencontre de l’Amour et de la Mort s’inscrit dans une réalité modeste et pourtant éclairante. On ne peut sans doute, nous les humains, que, non seulement accepter, mais désirer notre destin pour ce qu’il nous offre de capacité à aimer dans l’inappropriation, ce qui nous permet d’ailleurs de substituer au mot « conquête » – si tristement mêlé à l’Amour – le mot modeste de « quête » venu du Moyen-Âge, et qui dit que l’Amour est une recherche.
Je n’ai donc écrit ce livre d’ailleurs assez spontané, que pour dire une vérité simple : l’Amour a pris chez l’Homme la place discrètement religieuse d’une réparation heureuse. Il exonère de l’accusation dont il a fait l’objet dans notre Culture, voire de l’usurpation dont il fait les frais : aimer n’est pas faire la charité. Ce n’est pas un élan de l’esprit mais un déplacement physique de soi vers l’autre par l’effet d’une ouverture qui fait entièrement partie de notre respiration. On peut aimer l’herbe et la montagne, et quelqu’un ou quelqu’une qui, tout à coup, prend sens devant nous comme une partie de nous, voire une partie que nous avons-nous-même failli perdre.
Ce cœur de l’Amour, s’il passe aussi par le corps, appartient à ce que nous appelons la Nature. Il y a sans doute plus d’amour dans la chair – pour parler comme l’Evangile – que dans bien des théologies. Encore faut-il que nous nous aimions assez !
L’idée que le chemin passe ainsi par un « nous », ne saurait réduire l’Amour à quelque schéma que ce soit. Le « nous » se noue parfois hors des sentiers battus, et il y prend une forme singulière. L’Amour peut se cacher dans les sous-bois : le corps s’y met à ressembler aux arbres. En Poésie, l’Amour fait danser les mots.
Notre chemin n’en est qu’un parmi les autres.
Un dernier mot : je n’avais pas prévu d’écrire ce livre, « Notre chemin ». Il s’est fait presque malgré moi et devant moi, l’été dernier, à Granville, tout près de la mer. Il est venu comme revient la mer quand elle descend. L’idée même du livre n’aurait eu aucun sens et cependant, cela venait par petits bouts : c’est seulement à la fin que j’y ai pensé. Ou, si vous préférez, cela s’est passé comme la Vie : à la fin, les évènements prennent sens. C’est au moment où l’on commence à partir et c’est ce qu’on appelle « le bénéfice de l’âge ».
Marie-Christine et Philippe vont maintenant vous lire des bouts de ce chemin.
Bonne route avec eux !
**
*
Chapitre 1 – Dans la vallée
Philippe : p. 13 : « Il y a de ces paysages … »
Chapitre 2 – Gravité de l’innocence repêchée
M. Christine : p. 26 : « Mais toi qui es-tu … »
Philippe : p. 42 : « C’est le moment … »
Chapitre 3 – Recueillement des signes
M. Christine : p. 52 : « Nuit sans lune », puis « Je L’ai vue ce jour-là … »
Chapitre 4 – L’amour n’en finit pas de commencer
Philippe : p. 63 : « Est-ce le fruit de l’arbre … »
M. Christine : p. 66 : « Une fois que l’amour … »
Chapitre 5 – L’Amour contre la Culture
Philippe : p. 75 : « Et la pensée … »
M. Christine : p. 85 : « Printemps … »
Chapitre 6 – Quelqu’un vient
Philippe : p.112 : « C’est notre mort déjà … »
**
Jean-Pierre reprend la parole
Comme, à 95 ans passés, je ne suis pas sûr de vous rejoindre physiquement une autre fois, je tiens particulièrement à vous remercier de votre présence, de votre fidélité et de votre attention, sans publier Philippe TANCELIN lui-même, non seulement pour ses conseils toujours avisés mais pour son œuvre et son engagement au service de la Poésie et des personnes.
Ce qui se passe ici, grâce à lui, montre que la Poésie n’appartient pas seulement à la Littérature, comme nous l’avons appris à l’Ecole. Elle concerne la Vie et l’Amour de la Vie et des Humains, dans un monde qui se déshumanise tous les jours sous nos yeux. L’argent et le narcissisme, sans compter les abus de pouvoir dont sont victimes – fût-ce avec la bénédiction d’une certaine culture et d’une société également aveugle – des enfants et des adolescents, donnent la mesure d’une certaine complicité de notre monde avec le Mal.
Pour avoir dirigé moi-même pendant trente ans des institutions psychopédagogiques plus ou moins médicalisées, avec des équipes de 10 à 100 personnes, je m’étonnerais que des crimes comme ceux de Bétharam ne soient pas plus rapidement dénoncés, si je ne savais que la violence des adultes vis-à-vis des plus jeunes est l’objet d’un déni quasi culturel.
Et disant cela, je pense tout aussi bien aux abus de l’autorité qu’à ses défauts. Il y a là un sujet qui, hors les scandales, ne fait pas la « une » des journaux. On s’accommode d’une école qui, tantôt, méconnaît sa fonction éducative, tantôt la traîne dans la boue. La complicité objective de la société soutient cette situation. Notre culture « embourgeoisée » n’attend de l’Ecole que des « résultats » – au sens le plus étroit de ce mot – fût-ce, comme on vient de le voir, à Bétharam, cette école privée religieuse ayant pignon sur rue, au prix d’une violence parfaitement connue.
Or, on peut éduquer autrement ! L’autorité, quoi qu’on en pense, ne repose pas sur la force, si elle veut être éducative. Pas plus que la Poésie n’obéit à un « laisser-faire ». Je tenais à vous proposer ce lien. J’ai passé moi-même vingt ans de ma vie à soigner des adolescents dits difficiles dans un internat psychopédagogique, puis j’ai dirigé avec une centaine de collaborateurs un ensemble d’institutions spécialisées : hôpitaux de jour et consultations toujours destinés à des jeunes malades, voire très malades. Dix années sans aucun abus ! Cela n'est possible que si l’on conçoit l’éducation comme un soin. Comme la Poésie, le Soin ne repose pas sur la force, il en appelle au respect, voire à une forme d’affection vis-à-vis de ce que, chez les enfants et les adolescents que d’ailleurs nous continuons d’être nous-mêmes, relève d’une certaine forme de sacré.
Les faits que je viens d’évoquer s’inscrivent dans une dérive qui est une attaque contre l’Amour. Et cette attaque ne tombe pas du ciel, ou plutôt elle en tombe, quand l’abus de pouvoir et la haine du corps se parent d’une autorité qui s’attaque à l’Homme au nom d’un simulacre d’amour.
L’amour des bonimenteurs de service déshonore les prétendus héritiers d’un certain Sauveur.
Notre chemin, vous l’avez compris ne se fraye pas un passage dans ces marécages supposés spirituels.
**
*
Présentation par Jean-Pierre BIGEAULT, dans les locaux des éditions l'Harmattan, le 24 mai 2025 à Paris.
Intervenants lectures : Marie-Christine DAVID-BIGEAULT et Philippe TANCELIN
Captation : Benoît MARECHAL - Montage : Dominique MORLOTTI

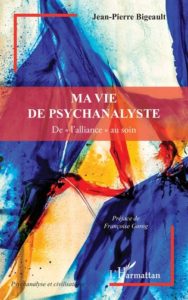 La psychanalyse est ce qu’en font les psychanalystes sur le terrain de la cure et de la psychothérapie comme dans leur vie. Entre la théorie et la pratique, s’ouvre le champ de la créativité d’un couple patient-psychanalyste, tel que le construit – en vue du soin – ce qu’il est convenu d’appeler « l’alliance thérapeutique ».
La psychanalyse est ce qu’en font les psychanalystes sur le terrain de la cure et de la psychothérapie comme dans leur vie. Entre la théorie et la pratique, s’ouvre le champ de la créativité d’un couple patient-psychanalyste, tel que le construit – en vue du soin – ce qu’il est convenu d’appeler « l’alliance thérapeutique ».
 « Ainsi avait retenti, par-delà le chant des automatismes, le cri de l’espace, cri joyeux d’une hauteur terrestre piquetant le ciel.
« Ainsi avait retenti, par-delà le chant des automatismes, le cri de l’espace, cri joyeux d’une hauteur terrestre piquetant le ciel. Il nous arrive de regarder notre vie d’un bout à l’autre, comme un paysage dont nous saisirions l’immensité d’un seul mot. Mais quel chemin entre soi et le monde, quand le mot dit et redit se perd à son tour dans l’étendue ? Ne faut-il pas approcher la mort, en s’avançant chaque jour, jusqu’à elle, comme nous irions au devant de la mer ?
Il nous arrive de regarder notre vie d’un bout à l’autre, comme un paysage dont nous saisirions l’immensité d’un seul mot. Mais quel chemin entre soi et le monde, quand le mot dit et redit se perd à son tour dans l’étendue ? Ne faut-il pas approcher la mort, en s’avançant chaque jour, jusqu’à elle, comme nous irions au devant de la mer ?