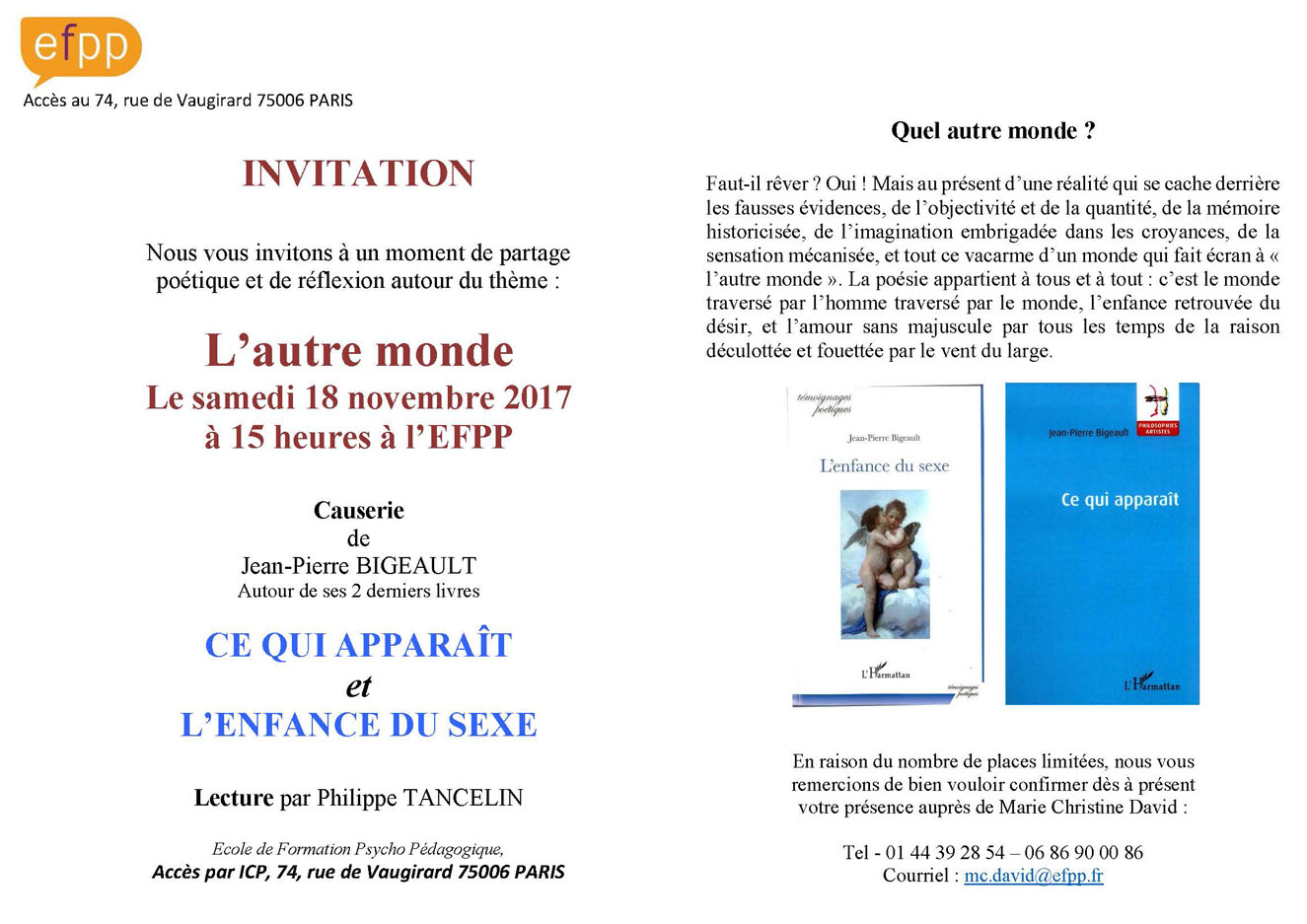Le mélange des genres – J-P. Bigeault – 15 juin 2010
Les circonstances qui nous réunissent m’ont dicté le sujet dont je vais vous parler et que j’ai concocté à votre intention comme un préambule à notre débat.
Puisqu’il s’agit de fêter à la fois la sortie d’un livre et l’âge de son auteur, mon sujet tout tracé s’appelle en effet “le mélange des genres”.
Mais ce sujet est moins circonstanciel qu’il n’y paraît. Il touche même à un point essentiel de ma vision de l’éducation et de la vie en général.
Avant de m’en expliquer, je dois vous dire que “le mélange des genres” a les meilleures raisons de nous faire croire qu’il ne procède que d’un accident de la logique voire d’une volonté délibérée de revenir à un stade supposé primitif de la nature tel que l’indistinction des origines.
C’est en effet que “le mélange des genres” nous renvoie à une réalité qui est aux antipodes de celle dont nous nous efforçons de croire qu’elle imprègne, voire gouverne notre pensée (ce que Descartes appelait les idées claires et distinctes) ou notre vie elle-même (notre identité, notre statut professionnel, sans parler bien sûr de notre sexe et de notre culture, références dont la solidité quelque peu illusoire nous est pourtant nécessaire !)
Ainsi “le mélange des genres” plus ou moins synonyme de confusion (confusion mentale, confusion des sentiments…) a-t-il vite fait de discréditer, dans l’ordre de la pensée comme dans la vie, ceux qu’on appelle des touche-à-tout voire des illusionnistes, pour ne pas dire des pêcheurs en eaux troubles, sans parler des enfants et des poètes !
Or cela provient, me semble t-il, de ce que “le mélange des genres” provoque souvent en nous ce sentiment “d’inquiétante étrangeté” dont parle Freud et qui ne nous renvoie pas seulement à l’inquiétude intellectuelle provoquée par l’incertitude des repères mais à la présence en creux d’une vérité que nous connaissons trop bien et qui cependant reste cachée – refoulée – en raison du trouble que sa révélation ramènerait à notre conscience. La rencontre d’un sosie (notre double) ou celle d’un transsexuel (l’autre de notre sexe); mais bien d’autres coïncidences non moins étranges, nous confrontent plus ou moins à ces réalités d’autant plus troublantes qu’elles nous sont, quoique nous en pensions, plus familières. Car nous savons bien que notre singularité et l’unité même du matériau dont notre image est faite ont aussi leurs limites !
Mais plus couramment, en tant qu’il se dessine comme l’ombre incongrue voire déplacée d’une réalité qui reste en nous toute brûlante sinon lumineuse, le mélange des genres se manifeste de façon plus ordinaire tant dans les exploits de notre vie affective que dans ceux de notre activité de pensée. Au début en effet d’une pensée créative (pour ne parler que du début !), les flammes entremêlées de nos idées et la part d’ombre qui s’y trouve encore attachée nous laissent entrevoir le foyer incertain d’où émergera, comme du cœur de notre planète, la croûte réputée féconde de notre discours. Quant à l’amour, si conscients soyons-nous des buts qu’il poursuit et des moyens que nous mettons en œuvre pour y parvenir, si, comme le disait Montaigne, les pièces qu’il réunit ne donnent même plus à voir la couture qui les a jointes, on admettra que Stendhal lui-même serait bien en peine de nous dire de quelles matières ces pièces sont le glorieux mélange, alors même que leur cristallisation en fait une seule lumière.
Mais laissons là ces mariages heureux où le mélange des pensées et des sentiments parvient à sublimer le malaise des étrangetés en le transformant en cette aventure familière de l’acceptation des différences qui fait de l’amour une expédition normalement exotique.
S’agissant (pour y revenir !) des circonstances qui nous réunissent, je parierais volontiers qu’à me suivre dans cette espèce de digression par laquelle je vous introduis à mon vrai sujet qui est celui de l’éducation, votre bienveillance amicale ne s’émeuve à tout le moins de la bizarrerie de ma démarche qui, à défaut de marier la carpe et le lapin, pourrait aussi bien passer pour s’appliquer à mettre la charrue devant les bœufs !
Revenons donc un instant à l’occasion qui, comme chacun le sait, fait le larron, et virtuellement à ces larrons en foire que sont les éducateurs !
Dans la circonstance présente – qui se doit d’être éminemment pédagogique – il me revient de vous faire admettre que mélanger l’âge du capitaine et le volume de la cargaison – c’est-à-dire le contenu du livre que je suis censé mener à bon port – permet de raccrocher la navigation de la pensée éducative à la réalité d’une expérience que j’oserais dire faite de pièces et de morceaux et condamnée à se développer dans une certaine forme d’instabilité en effet parfaitement marine. J’ajouterais, pour rester dans la métaphore océanique, que l’expérience que je rapporte se situe spatialement dans un malstrom avéré et que sa temporalité même s’apparente davantage à celle d’un voyage voire d’une petite épopée qu’à ce qu’on appelle simplement une histoire, pour la bonne raison que les effets y sont plus souvent à la recherche de leur cause que l’inverse. Mais mélange pour mélange, et roulis pour tangage, j’irais même jusqu’à dire, pour qualifier la situation en la rattachant au mélange, voire à la mêlée des gens qui s’y trouvent embarqués : la mer et le vent viennent enfin au bateau, selon que les marins, comme Ulysse, s’arrangent du mélange de leurs désirs avec ceux des dieux !
Je parle donc – vous l’avez compris – d’une expérience éducative qui mélangea son genre à celui de ma vie et de la vie de beaucoup d’autres, et je n’exclus pas que ces vies, se jouant elles-mêmes sur plusieurs tableaux, comme le conscient et l’inconscient – pour ne parler que d’eux – aient été à l’expérience ce que fut au destin d’Ulysse, le mélange des affaires rationnelles relevant du pilotage avec les autres, vouées à la dérive, où rôdent les images du sexe et de la mort.
De ce mélange difficile et cependant merveilleux vient évidemment le titre que j’ai donné à mon livre, ce livre dont, comme l’aède de la Grèce antique, je ne suis que le transmetteur vaguement homérique. “Une poétique pour l’éducation”, si elle prend le risque d’apparaître comme un traité sur l’éducation voire un catalogue raisonné de ses tableaux, n’est donc surtout dans son essence qu’un éloge de la navigation pédagogique à travers les “façons de faire” auxquelles nous invite et nous oblige son objet qui ne s’offre lui-même dans son essence que comme un chahut et un charivari d’eaux mêlées, un mélange de rêves et de réalités, une odyssée sans merci telle que l’expression “roman de formation” n’en serait que la forme atténuée, celle plus fréquentable d’une plage à marée basse.
Il convient donc d’entendre cette poétique dans la ligne de pensée qui, de Valéry à Bachelard et – plus près encore de notre idée d’engagement -, à René Char, s’emploie à faire ressortir les liens qui associent la contemplation à l’action et la connaissance objective à l’expérience du sujet connaissant.
Dans cette conception, l’objet éducatif n’est réductible à aucun des éléments qui le composent. Il ne peut être compris que comprenant lui-même – si restreint ou fugitif qu’il soit – une petite totalité de vie. Ainsi, l’éducation au « respect de l’autre » fait-elle appel, tout autant par exemple que l’apprentissage des opérations en mathématiques, à l’intégration de modèles plus complexes que ceux auxquels on est tenté de se référer trop vite et trop exclusivement en regardant désespérément vers la morale ou vers la logique. Le respect de l’autre se découvre dans l’exigence de réciprocité qu’implique la rencontre. Or, comment introduire, dans le partage d’un espace, d’un savoir, ou d’un pouvoir, la marge de frémissement par où passe entre les personnes l’assentiment à l’altérité ? C’est ici qu’interviennent par exemple ces toutes petites quantités d’éducation qui, d’un simple geste ou d’un regard, ouvrent le chemin à peine visible d’un échange qui prend déjà corps pour ainsi dire dans le corps. Il s’agit en effet pour l’éducateur, confronté au repli défensif des individualités, de solliciter cette perméabilité quasi cellulaire de la sensibilité qui permet ici aux images de soi et de l’autre de franchir les barrières d’une identité refermée sur sa peur. Ce mélange là, pour ainsi dire musical, c’est l’attention fine au bout des doigts de l’éducateur qui en devient le vecteur, alors même que le jeu relationnel s’élargit au clavier du groupe, ainsi que cela arrive à l’école dans la classe dite coopérative.
Mais on pourrait en dire tout autant de l’acquisition d’une pratique comme celle de la division en calcul numérique. La résonance imaginaire d’une telle opération – comme l’avait explicité il y a longtemps Mélanie Klein – invite sur les franges de la conscience des représentations corporelles et relationnelles qui justifient, si besoin est, que l’éducation les prenne en compte. De ce point de vue, on ne s’étonnera pas que l’esprit d’analyse puisse bénéficier d’exercices, qui, dans d’autres domaines de la symbolisation, travaillent sur la dialectique du démembrement et du remembrement. On dira donc que la danse comme la vie politique des groupes, utilisées à bon escient, sont susceptibles de contribuer au développement de cette capacité intellectuelle.
De ces constatations, il résulte que les moyens d’éduquer sont non seulement nombreux, mais contraints, eux aussi, de s’allier entre eux comme, dans un groupe bien décidé à faire quelque chose, les éléments hétéroclites de ce qui devient une équipe. Cela fait un peu pagaille ! Mais comme dans une démocratie, il arrive que cela aille dans le sens du développement des hommes !
C’est ainsi que je vois le moindre des actes éducatifs comme la touche de matière et de couleur ajoutée par le peintre à son tableau. L’isolation de ce point risque de nous faire oublier qu’il ne tire sa force que de s’inscrire dans un ensemble en épousant sa complexité, c’est-à-dire en se fondant dans le mélange dont il est fait lui-même.
Evidemment cette conception totalisante de l’éducation dont bien des pédagogies – et en particulier celle de Freinet – se sont inspirées, demande d’affronter le mélange des genres et le malaise plus ou moins caché qui s’attache à son désordre. Car s’il est plus facile de casser l’éducation en morceaux clairement distincts et rigoureusement séparés : enseignement, instruction civique, morale, voire plus récemment éducation sexuelle, c’est aussi que cela semble plus supportable. Si vous êtes professeur de lettres et que vous commentiez le texte célèbre de Châteaubriand consacré à “la prise de Moscou”, l’image de “la belle fiancée” offerte à Napoléon vous confronte d’autant plus au mélange des genres que ce mélange revêt une actualité percutante chez les adolescents que sont vos élèves. Vous êtes d’abord tentés de passer votre chemin. Cependant, si la force de l’image qui renvoie le sexe et la guerre à un certain fond commun de violence, au lieu d’ouvrir le chemin de la connaissance, se met à le barrer sous l’effet d’une excitation qui inhibe la pensée, que faites-vous ? Car, s’il vous vient à l’esprit que le traitement médiatique de l’information ne se prive pas tous les jours que Dieu fait de jouer sur une excitation du même genre -et cela avec toutes les conséquences psychiques, socioculturelles et politiques que l’on sait – ne croyez-vous pas qu’il est devenu urgent de mélanger l’analyse de l’objet avec l’analyse de son effet sur le sujet supposé pensant ?
Enseignant, j’ai été confronté à ces émois et à beaucoup d’autres moins immédiatement repérables. Et c’est d’avoir dû et pu mélanger la vie – ma vie – à mon métier, que j’ai mis en rapport les confusions vivantes dont ils tiraient, l’un et l’autre, leur force. Encore, si j’ose dire, fallait-il s’y coller ! Je veux dire mettre en face les facettes, supposées retenues à l’écart, de la vie et du métier. Admettre par exemple que le fameux objet sexuel, considéré comme un objet éducatif, ne cesse de se révéler, bien en deçà et au-delà de l’éducation comme le produit d’un mélange tout aussi primitif que savant et associant des éléments cognitifs et affectifs à une activité physique où l’esthétique, la morale et la politique entrent en jeu.
Mais le mélange des genres – quand bien même il semble s’éloigner de l’objet sexuel – nous y ramène toujours plus ou moins, si nous regardons fonctionner l’éducation dans la réalité des actes qui en relèvent et qui produisent véritablement de l’homme. Qu’il s’agisse en effet de l’enseignement ou de l’éducation, les acquisitions et les acquis constitutifs de l’homme proviennent d’opérations non seulement irréductibles à leurs aspects mécaniques, mais à vrai dire beaucoup plus proches de processus qui, pour être de l’ordre de la création, n’en rappellent pas moins à certains égards la procréation elle-même. Agglutinantes en effet, coalescentes, les alliances qui nous ouvrent la connaissance et nous permettent de l’intégrer redessinent leurs mélanges en liens qui se nouent : elles fabriquent de l’un avec du multiple et du social avec du subjectif.
On pourrait ainsi parler d’une érotique de l’apprentissage. On pourrait déjà dire qu’il y a une poétique de ce qui, pour s’intégrer en nous comme un nouveau savoir, doit être mélangé dans le creuset d’une expérience où se mêlent non seulement d’autres savoirs plus ou moins déjà assimilés et d’origines différentes, mais aussi d’autres humains que nous.
Je n’ai appris à lire dans Romain Rolland (j’étais loin de savoir à l’époque son lien avec Freud) qu’en mélangeant le plaisir singulier de son héros, Jean-Christophe, à diriger les nuages comme un orchestre, avec celui de notre maître à conduire la classe, et même avec l’amour secret que je portais à son visage comme à un ciel. Et beaucoup plus tard, n’ai-je pas vu bien des dyslexiques – qui se vengeaient comme ils pouvaient de buter sur les lignes barbelées de la langue, – ne devoir leur salut qu’à des pratiques du monde où l’inversion des signes comme la subversion des valeurs retrouvaient leur légitimité de protestation créative. A quoi servent des ateliers pédagogiques comme l’improvisation poétique ou théâtrale, sinon à rouvrir le champ des signes à la polysémie des mélanges où le langage se régénère.
Mais n’est-ce pas dans toute vie, et d’un bout à l’autre du parcours de la connaissance, et à plus d’une étape décisive, que les choses se passent ainsi : un mélange se fait entre les perceptions, les idées et les images du monde qui s’engouffrent en nous et nos vieux classements sont comme des râteaux devant la mer. Il nous faut, comme Ulysse roulé par la houle du large, nous enfoncer droits dans la mer brumeuse et gagner les terres incertaines.
Oui ! Quelque reproche qu’on puisse faire à la méthode globale, la bouillie originaire a encore de beaux jours devant elle ! Quant à notre poétique – qui, pour le cas où vous en auriez douté, se recommande beaucoup plus d’Homère ou de Montaigne que de Boileau – elle renvoie l’artiste à sa source qui, comme toute source, est d’abord un mélange de terre et d’eau.
Mais parler de mon expérience ne suffit pas. Comme la dédicace de ce livre en fait foi, une poétique de l’éducation renvoie à bien d’autres sources. Car le mélange des sources en éducation, c’est aussi le mélange de ceux qui la font et, dans les coulisses de ce petit théâtre, le mélange de ceux qui l’inspirent !
S’agissant des premiers, je dirais que les interactions qui commandent le processus éducatif ne se développent elles-mêmes qu’aux prix de mélanges bien spécifiques :
-Mélange des personnes et de leurs intériorités psychiques avec des dispositifs et des organisations qui ne jouent leur rôle structurant et médiateur que s’ils sont eux-mêmes sans cesse réinvestis par le désir de les produire.
-Mélange qui en découle de l’équipe éducative dont la fonction régulatrice dépasse largement l’ordre organisationnel, dès lors qu’elle permet, par la liberté cultivée de son mélange, le partage de ce qu’on pourrait appeler les intimités pédagogiques.
-Mélange enfin – tout aussi rarement réalisé malgré les grands discours et le laxisme ordinaire – de l’éducateur et de l’éduqué, voire – dans le cadre institutionnel – de l’ensemble ou des sous ensembles formés par les éducateurs et les éduqués dans le contexte d’actions communes, elles-mêmes productives de ce mélange toujours difficile de l’éducation et de l’institution
Mais ce dernier mélange – qui n’échappe, on s’en doute, à la confusion qu’au prix d’une construction sans cesse remise sur le métier – n’est évidemment pas tombé du ciel. Dans l’histoire institutionnelle que je rapporte, il a trouvé son inspiration dans les développements de la pensée qui ont marqué l’après guerre et plus particulièrement du côté de Freud et de Bachelard. C’est ainsi que la psychopédagogie alors naissante – celle-là même qui se trouve être encore l’emblème de l’EFPP – cette pédagogie qui entrouvre l’éducation française à la Psychanalyse, nous aura incités à repenser l’enseignement pour des adolescents dont les difficultés dites d’adaptation n’étaient pas liées à un déficit intellectuel. L’objectif rééducatif, voire tout simplement éducatif de cette démarche, devait prendre en compte les données particulières d’une institution qui avait la forme d’un internat. Cet objectif, dont Raymond Cahn ici présent aura été, non seulement le témoin amical mais le partenaire averti, a trouvé depuis lors, dans l’œuvre même de ce dernier, l’un sans doute des concepts les mieux adaptés pour en rendre compte :le concept de subjectivation, et, s’il se dessinait en filigrane de notre jeune pratique, c’était à travers l’idée que l’activité de connaissance devait être mise au service du développement d’un sujet ouvert, non seulement à sa propre construction, mais à celle de ses relations avec les autres.
Mais ce mélange capital de la Psychopédagogie n’aura pas été le seul à nous guider !
Dans une institution – qui se veut une école – fût-elle tournée vers l’éducation !- le mouvement dynamique de la connaissance doit être rapporté à ce qui en constitue l’économie propre. C’est ici que la pensée du philosophe des sciences, Gaston Bachelard, est venue soutenir notre intuition première.
Pour Bachelard en effet, qu’il s’agisse de la démarche scientifique de recherche ou de l’apprentissage demandé à l’enfant, à l’adolescent ou à l’adulte, l’accès à la connaissance ne procède pas d’une démarche linéaire et d’abord ordonnée : un mélange d’idées, d’images et d’états d’âme donnent au désir de savoir la force d’une impulsion où l’irrationalité même de « l’inconnu » joue un rôle primordial.
Mais la prise en compte de cette réalité première – sinon primitive – comme condition de la démarche doit s’accompagner d’une autre qui conditionne tout autant l’efficacité du laboratoire de recherche que celle de la classe. S’agissant de cette dernière, Bachelard parle d’une « pédagogie dialoguée » et il souligne que le mélange dialectique d’une certaine forme de réciprocité (entre les chercheurs mais aussi entre les maîtres et les élèves) et ce qu’il appelle très clairement « la régulation cognitivo-affective » de ce mélange sont également nécessaires. C’est dire si l’accès au savoir ne suit pas d’emblée la structuration d’une connaissance objective qui en reste pourtant le but !
C’est dire si le mélange le plus vivant d’où procède la connaissance nous rapproche d’une autre source ! Or, c’est bien celle – tout aussi bachelardienne que la première – à laquelle je me réfère pour parler d’une « poétique pour l’éducation ». Pour Bachelard en effet, la matière où s’enracine le désir de chercher et d’apprendre se constitue des mêmes éléments qui, dans la structure du poème, témoignent d’une activité de l’inconscient. Au point que le philosophe de « la Psychanalyse du feu » dit lui-même explicitement : « on ne peut étudier que ce qu’on a d’abord rêvé».
Que l’éducation s’inscrive elle-même dans cette ligne de pensée ne saurait surprendre. Dans le mouvement de connaissance qu’elle implique, l’éducation fait elle-même appel – à l’instar de la Science et de la Poésie – à une sorte de saut dans le vide ! Car tel est le destin de celui ou de celle qui va devoir passer d’un monde, supposé connu – bien évidemment assimilé à une forme de rationalité – à l’apparente irrationalité d’un modèle nouveau. Un tel saut qualitatif va chercher son énergie là où elle se trouve, c’est-à-dire bien en deçà de la rationalité du but poursuivi, dans les soubassements même du message adressé par l’éducateur à l’éduqué et qui a pour visée de faire accepter par ce dernier l’irruption d’une connaissance insolite.
C’est ainsi que je dois à mon propre père d’avoir découvert comme Montaigne, lorsque j’avais 10 ans, la relativité d’un principe que j’avais appris à l’école maternelle, lorsque ma première et vénérée institutrice m’avait fait comprendre que les billes de mon premier ami n’étaient pas les miennes !
Mais pendant la guerre… alors que les troupes allemandes d’occupation avaient installé leur cuisine dans l’école où je vivais, mon père, qui était un honnête homme, me pria de mettre à profit l’étroitesse de mes épaules pour me glisser jusqu’aux réserves de l’ennemi et y dérober quelques boîtes de saucisses, par ailleurs déjà récupérées par les allemands sur les anglais hâtivement rembarqués !
Ainsi, de même que les parallèles se rejoignent dans une géométrie non euclidienne, la bonne morale familiale se livrait à des exercices véritablement imprévus. Je ne suis pourtant devenu ni un héros, ni un délinquant ! Mais, pour tout dire, si l’aventure de ce mélange éducatif m’a appris quelque chose, c’est au visage lui-même mélangé de mon père que d’abord je le dois : son sourire sur fond de gravité douloureuse, le ton décidé en même temps qu’intimidé de sa voix, une référence un tantinet amusée à la sportivité de la situation. Cet ensemble de signes qui confèrent une autorité à la pensée, plus que le raisonnement, m’aura permis de comprendre que la justice et la liberté, sans parler de la survie, justifiaient que je sois fidèle autrement aux préceptes de mon institutrice.
Le sens ne vient donc aux choses que si nous les sentons d’abord s’inscrire dans la complexité vivante, ce mélange de corps et d’esprit, de ceux qui nous les apprennent et c’est à ce prix qu’elles s’inscrivent en nous sous les espèces d’une vision nouvelle.
Je parle de vision dans la mesure où, comme le poète – je dirais presque comme le mystique – je n’approchais l’incommensurable du haut des mes dix ans que dans la chaleur d’une image communicante – bachelardienne à coup sûr – où ma raison pouvait s’ouvrir au délire d’une loi nouvelle.
Mais pour vous aider à saisir la force du lien qui associe selon moi l’acte éducatif à l’acte poétique, permettez-moi de vous lire quelques lignes du texte du poète Pierre Reverdy1, intitulé « cette émotion appelée poésie » :
« En effet, pour si étrange que cela puisse paraître, ce sera la façon particulière de dire une chose très simple et très commune qui ira la porter au plus secret, au plus caché, au plus intime d’un autre et produira le choc. Car le choc poétique n’est pas de même nature que celui des idées qui nous apprennent et nous apportent du dehors quelque chose que nous ignorions ; il est une révélation d’une chose que nous portions obscurément en nous et pour laquelle il ne nous manquait que la meilleure expression pour nous la dire à nous même. Cette expression parfaite donnée par le poète, nous l’adoptons, nous nous l’approprions, elle sera désormais l’expression de notre propre sentiment qui l’épouse. »
Voilà, conclut Pierre Reverdy, pour ce qui est de la forme et du fond. Comme le poème, l’acte éducatif procède lui-même, selon moi, d’un tel mélange !
Mais, pour en revenir, dans le prolongement de ce texte, au mouvement éducatif de l’ouverture à l’objet inconnu et pourtant connu qu’on appelle aussi « l’autre », et au risque de vous entraîner encore un peu plus loin dans le mélange des genres, j’aimerais, pour amorcer la fin de ce propos, faire ressorti tout aussi bien la perspective ultime de l’éducation, sa contribution décisive à l’humanisation de l’homme telle que le philosophe Karl Jaspers la voit dans les derniers moments de la tragédie d’Hamlet :
“…C’est le frisson du savoir aux limites de l’homme. On n’y trouve ni mise en garde, ni préférence mais le pur savoir de l’être dans ce non savoir que dénonce sans trêve la volonté d’atteindre le vrai et qui met la vie en échec. “Le reste est silence”.
Et j’ajouterai :
Savoir et non savoir, bruit et silence, le mélange des genres est aux deux bouts du chemin !
Si l’éducation doit mélanger les genres jusqu’à de telles extrémités, vous comprendrez qu’elle bénéficiera de corriger sa dimension tragique par l’humour. Car l’humour reste la meilleure façon pour l’esprit de se raccrocher aux branches de la connaissance, quant il a compris que l’arbre du savoir est aussi celui de l’ignorance.
Le vieil Ulysse, en se nommant « Personne », pour échapper au Cyclope de l’angoisse, avait déjà atteint le fond et le sommet de ce mélange d’être et de non-être.
Dans Une poétique pour l’éducation, j’ai aussi voulu montrer que l’éducation était une chose trop sérieuse pour la confier à des éducateurs, je veux dire à des éducateurs qui ne verraient pas que le métier d’éduquer, comme celui de vivre, est aussi un jeu – un jeu de société, cela s’entend !
1 Sable mouvant, Poésie Gallimard, 2003