Une poétique pour l’éducation – De la psychopédagogie à l’art d’éduquer
 L'éducation est-elle une science ou un art ? Les deux, répond l'auteur ! Pour l'éducateur comme pour le psychanalyste, la théorie et la pratique se constituent en couple dans la réciprocité de leurs apports. Ce libre traité d'éducréation s'adresse à des praticiens : éducateurs et pédagogues en situation d'apprendre à apprendre mais aussi à être. Et à tous ceux qui tentent de théoriser l'éducation, il apporte le témoignage d'un acteur, historien et commentateur d'une aventure partagée en équipe.
L'éducation est-elle une science ou un art ? Les deux, répond l'auteur ! Pour l'éducateur comme pour le psychanalyste, la théorie et la pratique se constituent en couple dans la réciprocité de leurs apports. Ce libre traité d'éducréation s'adresse à des praticiens : éducateurs et pédagogues en situation d'apprendre à apprendre mais aussi à être. Et à tous ceux qui tentent de théoriser l'éducation, il apporte le témoignage d'un acteur, historien et commentateur d'une aventure partagée en équipe.
Editions L'harmattan - 2010
Pour avoir écrit en 1978 un livre intitulé « l’illusion psychanalytique en éducation », je me suis trouvé pendant plusieurs années invité à participer au colloque officiel de l’Education nationale sur l’échec scolaire ! Or, comme vous le savez, ni ce colloque, ni bien sûr ma modeste participation n’auront permis d’apporter des réponses concrètes à ce problème, récurrent depuis la dernière guerre, soit donc plus de 70 ans !
Au jour d’aujourd’hui je pense que j’aurais dû refuser d’intervenir dans ce colloque en tant que psychanalyste. C’est au nom de la Poésie que j’aurais dû le faire, car si la Psychanalyse ne peut servir directement la cause de l’éducation, la Poésie quant à elle – selon moi – en est capable.
C’est d’ailleurs pourquoi en 2009, dans un livre intitulé précisément « Une poétique pour l’éducation » – De la psychopédagogie à l’art d’éduquer », j’ai rapporté l’histoire d’une institution que j’avais créée en 1956 pour aider des adolescents en rupture avec le système scolaire. Cette expérience qui s’est développée sur une vingtaine d’années m’a conduit à penser que l’éducation au sens large du mot et la pédagogie en particulier ne trouvent leur véritable force que si elles s’inventent dans ce qu’on pourrait appeler une « création commune ». Cette « création commune », je l’ai baptisée « Poétique », parce que je pense que la poésie procède d’une source vivante et d’un partage singulier avec le monde. J’entends par là que si la poésie provient d’une personne – ou, comme on dit, d’un sujet – ce qu’elle fait du langage en le forçant dans ses retranchements conventionnels est un objet qui déborde les mots, comme un paysage les éléments et la personne elle-même qui le composent. Il n’est pas jusqu’à la poésie la plus classique qui n’en témoigne à sa façon. Lorsque Racine dit :
« Le ciel n’est pas plus pur que le fond de mon cœur », l’idée qui s élargit avec l’image s’ouvre à tous par-delà l’implication personnelle du poète et cependant nous entendons sa voix à nulle autre pareille.
Avant d’exposer ce que j’appelle « Poétique de l’éducation » je veux dire encore que l’histoire présente me convainc de l’intérêt d’en parler.
Au moment en effet où l’Education nationale affiche son intention de réduire l’échec scolaire en réduisant le nombre d’élèves par classe, je crois qu’il faut dire que cette mesure quantitative en appelle en tout cas une autre – celle-là qualitative – et qui porte sue la pédagogie elle-même. J’ajoute que sur un plan plus largement éducatif la question tout aussi actuelle de l’autorité ne pourra être elle-même magiquement traitée par le retour à un modèle qui n’a sans doute jamais existé que dans l’imagination de quelques pères rédempteurs.
Et je veux dire en terminant cette introduction qu’une « poétique de l’éducation » capable de répondre aux exigences que pose le traitement de l’échec scolaire, permettrait aussi bien de réduire l’échec en amont – par-delà les pédocentrismes et autres pédagogismes souvent plus idéologiques que pragmatiques – si elle intervenait de façon plus large sur les actions de transmission des savoirs, et donc en priorité dans le cadre de l’école mais aussi dans celui de la famille.
**
Je dois d’abord vous raconter comment la poésie a fait irruption dans ma toute première expérience pédagogique. Jeune professeur de lettres, je me trouvais en 6ème et en 5ème devant quelques élèves que l’expression française rebutait. Poursuivant alors de nouvelles études – en psychologie – je rencontrai le livre du psychanalyste suisse Charles Baudouin et j’y appris que les vieux mythes de la tradition gréco-romaine parlaient aux enfants mieux que tous les discours. Je me mis donc à inventer des sujets de narration qui reprenaient, peu ou prou, en les modernisant, des structures mythiques qui, si je puis dire, avaient fait leurs preuves. Conformément à mon attente, mes mauvais élèves se prirent au jeu. Et je compris bientôt que si l’inconscient de mes élèves y trouvait son compte, le statut poétique de ces mythes, plus ou moins délivrés de la réalité immédiate, les enchantait. Du reste les mêmes mauvais élèves pouvaient aimer Apollinaire et Max Jacob. De là je compris que nous devions donner aux textes, qu’ils fussent à lire ou à écrire, la capacité de s’offrir à un intérêt qui dépassait l’école. Les tissus dont ils étaient faits (car n’est-ce pas le sens du mot « texte » ?) devaient pouvoir se prêter à des opérations de découpage et d’enveloppement, telles que mes élèves, en s’attachant à leur matière, puissent aussi bien s’en rendre maîtres, que les suivre où ils les conduisaient, prenant des formes imprévues et presqu’inexplicablement familières.
Cette expérience m’en inspira une autre, alors que j’enseignais le latin en classe de seconde. La fameuse phrase dite « périodique » de Cicéron effrayait certains de mes jeunes latinistes. On s’appliqua, avant même de la comprendre, à la déclamer. Et une fois traduite, on poussa la plaisanterie irrespectueuse jusqu’à faire passer la pensée du maître-orateur par les fourches caudines d’une malheureuse histoire racontée dans un bistro. Catilina, l’escroc public rendu à sa banalité de filou, nous ne trahissions pas plus la majesté du discours cicéronien que Bossuet les cadavres des rois lorsqu’il rappelle que « le cœur de l’homme est creux et plein d’ordures ». Qu’un texte fût-il salué comme un modèle de notre classicisme – pût aussi descendre de sa hauteur pour remonter tel un tapage trop humain au sommet de sa construction musicale, n’était-ce pas le signe que nous renvoie la poésie elle-même lorsqu’elle fait tout avec si peu, voire lorsqu’elle brise les mots pour les rendre à la grâce qu’ils ont perdue ?
Par ces exemples vous voyez que ce que j’appelle « poétique » – pour désigner une pratique pédagogique – rejoint ce que fait le poète, lorsqu’il joue jusqu’à la désinvolture avec le discours convenu du monde, voire avec son amie intime : la langue. Car le langage, cet outil humain si merveilleux, n’est-il pas très vite une prison ? C’est aussi ce que pensent de l’école ces adolescents, voire ces enfants, qui s’y sentent enfermés derrière les barreaux d’un discours qui n’est pas le leur, ni même plus largement celui du monde dans lequel ils vivent. Telle est donc l’urgence poétique de la pédagogie : redonner la vie aux mots et aux choses dont ces mots semblent de pauvres masques. J’y reviendrai un peu plus loin.
En attendant, je reviens à cette poétique dont j’ai parlé plus haut et qui s’est élargie à cette institution rapidement évoquée. Après ce que je viens de dire de l’école, la question se pose : comment faire d’une institution autre chose qu’une institution instituée ? Comment faire que ceux pour qui elle est faite la produisent et qu’ainsi – pour faire le lien avec ce que je disais tout à l’heure – elle ne parle pas pour eux, à leur place ?
Il s’agissait d’un internat : cinquante adolescents et pré-adolescents venus de collèges et lycées et fichant le bazar, ou suicidaires, ou errants. Une douzaine d’adultes venus de tous les horizons, recrutés selon la richesse de leurs parcours humains (de guerre et d’après-guerre) et diplômés de quelque chose, mais surtout prêts à tout. Ce fut un poème épique ! Je veux dire par là que tout pouvait arriver et arriva – jusqu’à un incendie que je raconte dans un prochain livre et qui fut allumé par un élève en détresse. Mais aussi – sans doute plus créatif mais guère moins difficile – la réalisation d’un film où les généreux adultes que nous étions durent jouer le rôle de kapos dans un camp de concentration. Car c’est ainsi que nos élèves nous voyaient et voyaient en nous ceux dont ils avaient peur.
Au jour le jour la poétique se réalisait à la fois dans la pédagogie et dans l’éducation par la place de la parole. Qu’il s’agisse de la classe, de la chambre, de la salle à manger, du parc, ces espaces pouvaient être parlés et leur fonctionnement ainsi revisité, échapper à la pesanteur des modèles, à leur dissémination autant qu’à la fausse unité de leur assemblage apparent (lecture : « les grottes »)
Travail d’élucidation dans le respect des zones d’ombre, travail de remise en cause et d’accueil : on est là pour vivre avec ce qui est là et on le réinvente. Cela repose sur l’équipe des adultes et sa dynamique certainement originale en ce sens qu’elle ne procède par d’un savoir déclaré. Notre institution « psychopédagogique » peut toujours porter le nom d’une science qui reste à inventer, les psychopédagogues que nous sommes sont d’abord des personnes qui cherchent à faire de l’éducation à partir de ce qu’elles vivent. « Pour vivre ici » comme dit le poète Paul Eluard. En tant que professeurs et tout à la fois éducateurs (car nous partageons les soirées et les nuits auprès de nos élèves), nous nous occupons de tout. Ce que pourtant chacun sait de son expérience est confronté chaque jour à une réalité non sue.
Sous ce rapport j’appelle « poétique de l’éducation » ce qui ressortit pour les maîtres eux-mêmes à une forme d’apprentissage, ce qui ne signifie pas davantage que nous nous situions au même niveau que celui de nos élèves. Car c’est à nous que revient l’autorité de ceux qui, en dernier ressort, assurent la souple solidité du cadre.
Mais plutôt que de développer cet exemple, je dois vous dire que, mutatis mutandis, j’ai retrouvé une poétique institutionnelle de ce genre dans un cadre somme toute plus rigide que celui d’une école. Il s’agit d’un hôpital de jour pour adolescents créer et dirigé par mon ami le Docteur Raymond Cahn. En tant que responsable moi-même de la structure associative qui soutenait cette institution, j’y ai vu une équipe développer sur 20 ans une prise en charge à la fois thérapeutique et éducative (et même scolaire) qui aura elle-même été fondée sur la créativité collective.
Par ces exemples – et je pense aussi à des expériences qui, dans le cadre de l’Education nationale elle-même, ont ici et là fait leurs preuves – j’ai voulu souligner que l’éducation – fût-elle scolaire passe par la réalité des personnes comme non seulement son canal mais son levier. Le creuset de l’alchimiste éducatif ne permet la transmission des savoirs que selon l’implication des acteurs dans un mélange actif où les matières humaines se rencontrent et se conjuguent entre elles. Qu’on utilise tant qu’on voudra les ordinateurs pour faciliter certains apprentissages, ce qui relève à proprement parler de l’éducation n’y trouvera pas son compte. Les poètes – et j’en ai vu parmi les adolescents que j’évoquais tout à l’heure – vont à la langue comme à une source, et la question de l’irrigation ne se pose qu’après. Le professeur – et je revois et je ré entends ceux qui m’ont le plus apporté – nous prend sur son dos d’homme et il mélange ainsi dans son corps et sa posture, ce qu’il sait avec ce qu’il est, et avec nous, comme si c’était pour lui aussi la source où il nous conduit.
Mais, pour terminer, je voudrais m’attarder un instant sur certaines des raisons qui me paraissent constituer en profondeur la difficulté que nous avons d’accéder à cette poétique de l’éducation. Ces raisons sont pourtant celles qui nous invitent à y recourir.
Du côté de l’élève la curiosité de l’enfant n’est pas si homogène qu’on veut bien le dire. Elle est traversée par des peurs. La compulsion de répétition oppose une limite au goût de l’aventure. Les objets du savoir ont souvent l’air de fantômes, quand ils ne font pas penser à des vampires. Leur appréhension – au double sens de ce mot : s’approcher pour prendre et redouter – ne saurait toujours déboucher spontanément sur l’apprentissage. Il s’agit donc de dédramatiser la situation – et pour nous qui idéalisons le savoir, quelle découverte ! voilà qu’il nous faudrait revenir à cette attitude protectrice dont la dimension plus ou moins maternelle nous donne le sentiment de régresser. Et pourtant le jeu du poète n’est pas un enfantillage.
Et du côté du maître en effet les choses ne sont pas aussi claires qu’on veut bien le dire. Que le maître soit confronté ou non à la dérobade ou au refus de l’élève, sa position vis-à-vis du savoir mérite d’être interrogée. Si on a longtemps suspecté les conditions d’apprentissage que certains patrons réservaient à leurs apprentis, on a eu un peu vite fait de penser que les maîtres d’école – pour ne parler que d’eux – étaient innocents en la matière. Pourtant la simple observation de milieux intellectuels montre bien que l’affaire est plus compliquée. Bien des thésards que j’ai suivis en psychothérapie m’ont apporté là-dessus des témoignages édifiants. Le savoir qui donne un pouvoir n’est pas plus neutre pour celui qui le possède que pour celui qui est censé l’acquérir. Or le pouvoir du maître s’ajoutant à celui – fantasmatique – de l’objet-fantôme dont je parlais tout à l’heure le blocage de l’élève a tôt fait de se renforcer. Et pourtant « l’autorité » du maître ne saurait être escamotée au profit d’une fausse égalité entre l’élève et lui. C’est alors que tout se joue, tout peut se jouer dans l’aventure du partage : le maître n’est pas un livre, il invente à mesure, il redécouvre ce qu’il a appris et cette dynamique lui vient aussi, s’il y prend garde, du groupe même de la classe et – je le redis avec force ! – de l’équipe éducative, pourvu qu’elle se vive comme telle.
Ces dernières remarques laissent entrevoir en effet ce que peut être le cadre psychologique et psychosocial d’un acte éducatif et pédagogique. Qu’il s’agisse de l’élève ou du maître, le mouvement qui porte la transmission me semble devoir être celui d’une création commune. Je n’ai véritablement appris et je n’ai su enseigner la grammaire française que lorsque je l’ai redécouverte (quinze ans après l’avoir enregistrée) dans un livre intitulé « Grammaire psychologique » (Galichet) et quand donc, retrouvant pour moi-même cette fraîcheur de l’apprentissage, je me suis mis à mettre en scène avec mes élèves la danse des mots et ses figures. J’étais porté – il faut aussi le dire – par la fameuse école où tout cela nous arrivait.
Pour dire cette créativité pédagogique et éducative j’ai employé le mot « poétique » parce que la poésie va chercher les choses derrière les choses en s’en donnant la liberté. Et aussi, parce que le poète – en dépit de l’image qu’on se plaît, voire qu’il se plaît, à en donner – n’est pas seul. En tant qu’aventurier et découvreur, il appartient à la communauté des chercheurs d’or, son or étant le désir des hommes pour la parole, celle dont Homère dit qu’elle est faite de « mots ailés ». Il arrive qu’un maître semble se détacher de ce corps vivant des poètes. Mais en réalité c’est un peuple silencieux qui vit avec lui. Son narcissisme se fond dans l’espoir d’un objet partagé – l’objet humanisé que le mauvais élève n’aperçoit encore que dans sa haine ou sa mélancolie hargneuse. Et le maître, si souvent déprimé lui aussi, le déteste et l’aime. Au fond, je pense que l’éducateur, fût-il enseignant, n’a choisi ce métier que parce qu’il a un compte à régler avec le savoir. Faire de la transmission son travail, c’est, en s’identifiant à tel ou tel savoir, le jeter hors de soi tel un ami-ennemi qu’on offrirait à un dieu inconnu. Il y a une violence contre soi-même dans cette volonté d’accroître l’autre d’une partie de sa propre richesse, comme sans doute dans ces actes de charité dont profite, qu’on le veuille ou non, un certain ordre du monde. Une ambivalence rôde dans les couloirs. Comment la déjouer sinon en délivrant les savoirs des jeux de pouvoir auxquels ils se prêtent, et en se rapprochant soi-même – avec l’élève – de ce plaisir d’aller ensemble vers des objets inconnus, étoiles perdues à retrouver. Et n’est-ce pas le chemin du poète ? Retourner les forces négatives – comme je l’ai évoqué – fût-ce en satisfaisant transitoirement leur capacité de destruction, car les savoirs ne procèdent-ils pas eux-mêmes, comme le disait Bachelard, d’une forme de violence, n’est-ce pas aussi ce que fait le poète ?
Le poète, comme l’enfant, comme l’adolescent, se libère de ses propres jouets en retournant contre eux une partie de la colère que nourrit en lui sa dépendance, car savoir c’est aussi perdre le bénéfice de ce qui, dans le rêve, ressortit à l’innocence.
En terminant je voudrais battre en brèche l’idée que l’éducation serait l’arme d’une guerre contre la barbarie qu’on appelle ignorance ou pure et simple violence. Les savoirs accumulés dans la culture européenne du XXème siècle ont montré leur capacité à soutenir des projets stupides et cruels. Les figures de l’autorité utile sont plus souvent discrètes que celles qu’on brandit au-dessus de la mêlée comme des statues au front divin. Revisitons plutôt nos propres histoires.
L’éducation – celle qui nous a aidés à vivre la vie – y compris par les savoirs dont nous sommes les plus fiers – est une suite poétique souvent cachée dont nous savons que les pères et les mères plus ou moins symboliques qui nous l’ont donnée furent aussi nos frères et nos sœurs dans le partage, et sans que l’autorité s’y ordonnât selon celle des machines, nos nouveaux dieux.
24 novembre 2017, Intervention in Collectif Effraction,
Poètes des cinq continents, l’Harmattan, Jean-Pierre BIGEAULT
J’espère qu’il n’est pas trop tard pour parler du livre fort stimulant que Jean-Pierre Bigeault a publié il y a deux ans. Je ne le crois pas, car les problèmes que pose le métier d’éduquer (un des « trois métiers impossibles » comme les a nommés Freud) nous taraudent depuis des siècles et vraisemblablement continueront à le faire longtemps. En outre, Bigeault fait état d’une expérience originale : la création d’un internat pour des jeunes en situation d’échec scolaire, de son fonctionnement, de ses avatars et de sa fin. Pour ce faire, il y met toute sa fougue bien connue, ses compétences, son attrait pour la poésie et pour l’acte d’éducation.
Voici donc un ouvrage extrêmement vivant, plein de chemins de traverse, « de remords, de doutes, de contraintes » (Paul Valéry) où l’auteur se livre tout entier. Ce qui en fait son charme et en même temps son aspect un peu « ésotérique » car il est toujours difficile de comprendre et de bien interpréter la dynamique d’un auteur (et de l’institution qu’il livre à notre réflexion) quand celui-ci fait montre d’une volonté d’exhaustivité qui peut dérouter le lecteur. De plus, l’auteur ne recule ni devant une argumentation scientifique, ni devant un désir d’« enchanter » le lecteur en lui ouvrant les portes d’une expérience « poétique » de recherche-action étalée sur de nombreuses années, mélange de genres auquel les pédagogues ne nous ont guère habitués.
Ceci étant, je n’ai pu m’empêcher de céder au charme de cet ouvrage. Certes, une raison personnelle m’y prédisposait. Non seulement je connais bien Bigeault, mais j’ai rencontré et apprécié plusieurs membres de l’équipe qu’il avait réunie au moment même où cette expérience se déroulait et j’avais été extrêmement intéressé (même si je la trouvais utopique et passablement risquée) par l’aventure que ce groupe était en train de vivre. Pourtant, j’estime que tout lecteur « naïf » peut faire son profit de ce livre. Il faudra seulement qu’il soit un peu plus attentif que moi et un peu moins bien disposé que je le suis spontanément.
Je n’ai pu m’empêcher, durant la lecture de ce livre, de penser à Jorge Luis Borges et à Lewis Carroll. À Borges, tout d’abord parce que l’expérience relatée ressemble à un « jardin aux sentiers qui bifurquent » tellement il se passe d’événements contradictoires qui mettent continuellement l’institution créée (intitulée « La Maison rouge ») en situation périlleuse car elle risque toujours de suivre des voies sans issues bien qu’elle arrive toujours à se rétablir. Et puis aussi à cause d’une référence implicite : l’auteur écrit que « ce qui nous permet d’aller vers la montagne [il a comparé les cinquante adolescents que l’équipe prend en charge à une “montagne volcanique”], c’est que la montagne nous contient » ; ce qui ne peut que faire penser à la figure du « tigre », fréquemment évoqué par Borges, que nous craignons mais qui en même temps est nous-mêmes. (« Je suis le tigre », écrit Borges.) En définitive, ce qui manque d’exploser ou de nous tuer, c’est aussi les « tunnels » que nous creusons (p. 83-84). Enfin, parce que la tonalité générale de l’ouvrage, avec ses rebondissements, fait songer aux faux romans policiers qu’écrivait Borges en compagnie de son meilleur ami (et également grand romancier) Adolfo Bioy Casares.
Lewis Carroll ensuite. Non Alice au pays des merveilles ni Au-delà du miroir, mais le poème débridé La chasse au Snark, qui a été tellement apprécié des surréalistes.
En effet, comme l’écrit Raymond Cahn, qui a fait partie de l’équipe de Bigeault et qui préface le livre, ces « éducateurs » ont tenté « l’aventure d’embarquer dans leur bateau quelques dizaines de naufragés de l’enseignement secondaire ». Il ajoute que « le pari, sans modèle, ni recette, sans la moindre expérience d’une action de ce genre [je souligne], fut de partir de cette mise entre parenthèses de tout a priori et d’inventer leurs propres solutions face à tous les problèmes où ils se trouvaient confrontés » (p. 9). Dans La chasse au Snark (animal fabuleux), un capitaine (nommé « l’homme à la Cloche ») embarque avec lui pour chasser le Snark des gens sans la moindre compétence (ex. un bottier, un faiseur de bonnets et capuches, un avocat, un agent de change, etc.) qui apprécient sa sagesse jusqu’au moment où ils s’aperçoivent qu’il ne sait que bien faire une chose, « agiter sa cloche ». Certes, l’équipe de Bigeault est plus armée que cet équipage farfelu, mais elle n’a aucune expérience de ce genre et leur chasse (comment éduquer les élèves, comment développer leur capacité créatrice, comment mêler connaissance de l’inconscient et primauté de l’activité cognitive), bien que spirituelle, ne manque pas de faire penser à tout éducateur (à tout enseignant et formateur tel que je le suis) qu’elle ressemble étrangement à la découverte d’un Snark, c’est-à-dire d’un animal bizarre qui, en plus, peut devenir un « Boojum », autrement dit un être qui vous fait disparaître. Tout éducateur, tout enseignant a dû se poser non seulement un jour mais continuellement la question : mais qu’est-ce qu’éduquer ? Que poursuivons-nous ? Quel est le but, la finalité, la valeur de notre action ? Apportons-nous la connaissance, l’expérience, la sublimation ou « faisons-nous chier les mômes », comme disait Zazie ? Faisons-nous du bien en permettant aux élèves de développer leur créativité ou sommes-nous les messagers du mal ? Les élèves peuvent-ils évoluer, se transformer ou nous brisent-ils en nous renvoyant à nos peurs et à nos fantasmes ? En fin de compte, existe-t-il un art d’éduquer et un art d’apprendre ?
Le voyage auquel nous convie Bigeault est plus assuré que celui inventé par Lewis Carroll mais nous voyons continuellement cette équipe devoir inventer le mouvement pour éduquer, comprendre les symptômes, faire un « travail d’équilibriste » (p. 81), devoir se confronter à des difficultés lourdes, se sentir en situation « d’errance sociale » (p. 103), essayer comme l’écrit René Char de « s’expatrier de son huis clos » (p. 258), tenter d’apparaître comme des « donneurs de liberté », d’apporter une « poétique de l’éducation qui soit une poétique du plaisir » (p. 244) pour tous. Chacun essaie d’être, comme Montaigne, « homme d’action, et tout autant, homme de lien, homme qui n’aura jamais séparé l’autorité de l’amitié ». Il recherche non seulement en lui mais en l’autre ce que l’auteur des Essais appelle « la maîtresse forme » (p. 296). Mais tout cela ne peut durer qu’un temps car « les exercices de haute voltige », le « travail sans filet » (p. 242) va se heurter à des impératifs administratifs et la fin sera amère. Cela n’empêche pas l’expérience d’avoir été passionnante. En terminant ce bref compte rendu, je me rends parfaitement compte que j’ai dit peu de choses du contenu de cet ouvrage, des réflexions fort pertinentes sur la psychopédagogie, sur les théories mises en œuvre et continuellement réévaluées dans la pratique, sur les rapports de la poésie et de l’éducation. C’est, tout simplement, parce que je désire que le lecteur lise ce texte tranquillement et non pas qu’il se contente du résumé que j’aurais pu lui apporter tout cuit.
Il me faut néanmoins évoquer deux réserves importantes. a) Le livre aurait dû être plus court. En voulant dire le maximum, évoquer longuement la poésie de René Char, Bigeault a cédé au plaisir de l’écriture. Seulement, le lecteur moderne aime aller à l’essentiel et il peut être réservé devant un livre de trois cent cinquante pages. b) En mettant à la fin, en un « Album » de cinquante pages, les événements qui ont scandé la vie de l’institution, l’auteur a rendu moins vivant son livre. Pour ma part, chaque fois que l’un de ces événements était cité dans le corps du texte, je me suis reporté à l’album et cela m’a rendu la lecture plus agréable et moins aride.
Ces deux réserves ne doivent pas empêcher le lecteur exigeant de lire avec plaisir un texte fort bien écrit et, vu que Bigeault s’est lui-même défini comme un trapéziste, je ne peux que lui dire : « Salut l’artiste ! »
Eugène ENRIQUEZ – In Nouvelle revue de Psychosociologie – N°14 – Février 2012

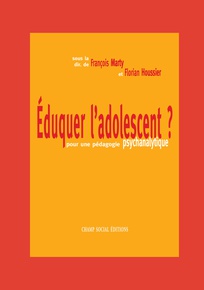

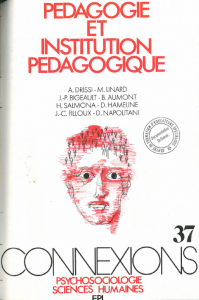
 Jean-Pierre Bigeault - Claude Terrier
Jean-Pierre Bigeault - Claude Terrier Gilbert Terrier et Jean-Pierre Bigeault
Gilbert Terrier et Jean-Pierre Bigeault Harold PORTNOY et Jean-Pierre BIGEAULT
Harold PORTNOY et Jean-Pierre BIGEAULT