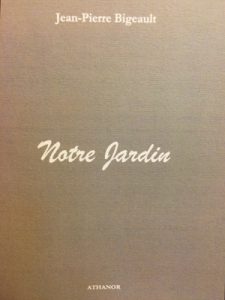
Paris, Éditions Athanor, 2011
Notre jardin
Il s’est trouvé que le développement de ma réflexion sur la vie humaine et le soin qu’elle réclame m’a fait revenir au temps lointain où, jeune et moins jeune adolescent, je devais accompagner mon père dans la culture d’un jardin qui, pendant la guerre et l’après-guerre, assurait notre nourriture. C’était un travail dont j’ai pris conscience qu’il n’avait pas seulement nourri mon corps et le corps de ma famille mais le coeur et l’esprit confrontés à la terre et à ses productions, comme ils l’étaient déjà, à l’époque, aux sentiments et aux idées qui forment en nous et au-delà de nous un tissu continu et discontinu dont la matière mérite bien, elle aussi, de faire l’objet d’un jardinage.
A regarder ce que tout cela était devenu dans ma propre histoire, il m’est apparu que les fruits dont la récolte se poursuit aussi longtemps que dure la vie, n’avaient muri – et ne murissent encore pour certains – que de l’amour qu’y avaient porté les mains mais aussi e refard et l’écoute des jardiniers qui, avec moi, s’étaient employés non seulement à les connaître mais à les reconnaître. Car il ne suffit pas de connaître les gens et les choses en les nommant et les comptant comme pour un inventaire, faut-il encore les associer à ce que nous sommes. Dans un jardin, le jardinier n’administre pas la terre, il la laisse entrer dans sa vie d’homme et en même temps il la rencontre dans son intimité presque charnelle.
Ainsi ai-je compris que ces liens qui, comme les plus beaux de nos projets, sont les graines de notre vie ne la font pousser que si nous les traitons avec la même profonde affection que s’ils appartenaient à notre corps, que s’ils en étaient les cellules. La matière dont nous sommes faits n’est-elle pas en elle-même ce vaste ensemble qui réunit des atomes et entre les atomes le filet des lumières qui font vivre la nuit comme le jardin la terre.
Et voilà ! Dans un monde dont le matérialisme ne respecte pas plus la matière qu’il ne respecte l’homme dans leur poésie – qui est un jardin et une planète à elle seule – je me suis dit qu’il fallait que les mots – qui sont aussi des mottes de terre compactes et vite égrenées – viennent s’ajouter à celles du vrai jardin comme les baisers des amoureux aux bonjours du soleil et aux murmures vespéraux de la lune.
Le petit livre ainsi intitulé « Notre jardin » contient un plus grand poème qui a donné son nom au recueil. Ce poème a pour centre le jardin qui entoure le musée Rodin à Paris. Mais ce qui s’y passe entre un homme et une femme qui commencent à s’aimer montre que la sculpture de l’amour est un mouvement qui emporte les corps dans un espace qui les dépasse, alors qu’ils gardent précieusement en eux le secret de leur source déjà plus grande que tout ce qu’ils en ont fait et en feront.
Les poèmes qui précèdent ce plus long texte célèbrent la gloire de l’enfant qui joue à inventer le monde, ce jardin dans lequel il poussera, souvent un peu en marge de la famille et de l’école et presque en concurrence avec Dieu, tant sans en avoir l’air il prend la vie au sérieux dans son foisonnement de fête.
Ainsi le petit garçon, qui n’a d’abord fait que traverser le monde à la vitesse de ses jouets, en pénètre t’il peu à peu la multiple géographie. Passant d’une peu de papier à l’enveloppe herbue des prairies, il voit bien que l’amour est un paysage qui ne craint ni le désert ni l’exil, car le jardinier qu’il devient n’est plus jamais seul : il chante avec la terre et d’un visage à l’autre avec la pensée caillouteuse et tendre de ce grand corps étoilé.
Les derniers poèmes pourraient être la conclusion.
De ces formes entremêlées que jardinent les mots se détache un visage qui est une figure où la matière devient sa propre fleur. Ainsi l’espace dont nous avons parcouru, enfant, la géométrie palpable s’est-il converti en théorème, en même temps que l’amour qui vient de la nuit se construisait en espérance de bien avant le soleil. C’est la proposition qui inspire la toute fin de mon petit livre : Tout a commencé bien avant le commencement !
Et n’est-ce pas dans cette perspective que les photographies que Bruno Gaurier a fait entrer dans le texte de ces poèmes, sont venues à la rencontre de ce qu’ils cachent, non pas en le dévoilant mais en en renvoyant le mystère visible à son silence. Notre matière – serions nous sourds et aveugles ! – chante en nous comme un regard. Entre le photographe qui écoute ce regard et l’enfant qui en dessine la musique, il y a un pacte. Nous ne parlons que de ce qui a précédé les mots et les images comme si nous parlions de l’amour repris à ses débuts, quand il n’est encore qu’un murmure.
Ainsi, plutôt que de nous placer dans un monde qui ne serait pas né ou dans l’au-delà d’un monde déjà mort, ces jardiniers-là que nous sommes – qui cultivons la terre humaine – nous reconnaissons dans l’enfance dont le poète Rainer Maria Rilke disait en son temps déjà :
« Moins protégée que les bêtes en hiver,
Elle est sans défense
Comme si elle était elle-même ce qui menace,
Comme un incendie, un géant, un poison,
Comme ce qui, la nuit, rôde dans la maison suspecte
Pourtant bien verrouillée. »Notre jardin, qu’il soit celui du poète ou de l’éducateur, ou de l’enfant lui-même – est fait de cette terre-là si vite dénoncée et répudiée comme la vie elle-même, alors qu’elle n’est qu’aux antipodes de l’exploitation si souvent haineuse qu’on en fait, que le symbole de ce que le même Rainer Maria Rilke appelait :
« la fructifiante enfance »
Jean-Pierre Bigeault
2 décembre 2011 à l’EFPP


