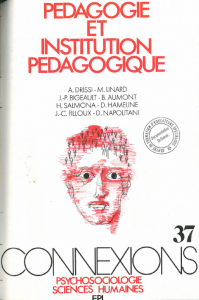Une poétique pour l’éducation. De la psychopédagogie à l’art d’éduquer
Voici un ouvrage qui tombe à pic. En conservant une perspective psychanalytique, J.-P. Bigeault revient en toute liberté vers cet objet de pensée et de pratiques, la psychopédagogie, qui comme le sable coule entre les mains, ne cesse de nous échapper et de faire retour. Dans le contexte social actuel où la logique économique sert d’idéologie, portant l’utile au pinacle, l’auteur nous invite à un voyage au pays de l’éducation, promulguant un savoir-faire qui ne saurait se passer d’un certain savoir-être. Le décalage créé par le titre de l’ouvrage est bien une invitation, à rêver plutôt qu’à compter, à penser/vivre plutôt qu’à agir. Une mise en perspective plutôt qu’une recherche de la mise en acte, écrit l’auteur.
Dans cet ouvrage découpé en trois parties – historique, pratique, poétique –, il est question de co-créer un tissu institutionnel sur fond d’espace de rêverie partageable. Cet espace, aux effets non prédictibles, a pour visée de mieux accompagner les adolescents en souffrance qu’il accueille. R. Cahn l’évoque, dans la préface : face à ces adolescents, il est essentiel, voire vital, de rester inventif dans le dispositif psychopédagogique dont on croit tenir les rênes, de se laisser surprendre, et donc de ne rien figer dans des positions trop conventionnelles. On tient là, par l’abord historique des pédagogies nouvelles et de l’espoir (de l’utopie ?) partagé avec la psychanalyse, un contre-modèle de nombre d’institutions qui ont tenté ce geste envers ces adolescents : si l’institution est une création profondément humaine, elle ne peut qu’être traversée par les conflits et l’ambivalence de ceux qui la portent. Prendre en compte ces mouvements, ne pas les repousser mais plutôt les accueillir, implique une forme d’éloge discret du désordre, doublée d’une impossible modélisation. C’est peut-être là une des réponses possibles à l’idée proposée par J.-P. Bigeault : la psychopédagogie pourrait bien être une étoile morte. En l’absence de toute systématisation, la psychopédagogie est un mélange hybride de théories potentielles dont la diversité fait le sel ; elle est heureusement condamnée à se réinventer en fonction de chaque contexte et de chaque retrouvaille avec ces adolescents si dérangeants pour nos certitudes. Avec eux, impossible de s’endormir, ils nous tiennent éveillés même la nuit.
On ne trouvera donc dans cet ouvrage aucune thèse récurrente mais plutôt le récit d’un work in progress institutionnel qui a valeur d’expérience unique – et à ce titre remarquable, paradigmatique. Quant aux adolescents, la position adoptée par J.-P. Bigeault n’est pas sans rappeler la proposition faite par S. Freud en 1913, considérant que les tendances perverses et asociales doivent être vues comme le moteur de ce qui peut être transformé par la sublimation, et non un ennemi moral à combattre : « Nos plus hautes vertus se sont élevées, par des formations réactionnelles et des sublimations, de nos pires dispositions. L’éducation devrait scrupuleusement s’empêcher d’enterrer de si précieux ressorts d’action et devrait se limiter à encourager les processus par lesquels ces énergies empruntent des voies saines. »
En remontant aux fondations de la psychopédagogie, l’éducation apparaît comme un acte non seulement poétique, mais aussi, depuis toujours, politique. On repense à A. Aichhorn, au début du xxe siècle, créant des foyers éducatifs pour adolescents afin que ceux-ci ne soient pas embrigadés dans des mouvements paramilitaires annonçant le pire (l’instrumentalisation de la jeunesse, le nazisme…). Aujourd’hui, il demeure toujours suspect de penser ailleurs que dans un objectif précis, comme de viser la réussite scolaire à tout prix. Mais, comme le remarque l’auteur, les projets psychopédagogiques comme celui de Bernfeld et Hoffer en 1918 se heurtent à un obstacle récurrent : l’idéalisation, qui apparaît comme un leurre nécessaire, comme le bébé devra se désillusionner après avoir nourri l’illusion qu’il est le monde.
Qu’il s’agisse d’« ambiance psychothérapique » ou de « psychothérapie orchestrée », la psychopédagogie veut malgré elle quelque chose : agir sur les blocages inconscients en passant par la bande, par des dispositifs mettant la créativité et le décalage au premier plan. La prise en compte de l’environnement, familial et social, est aussi sa marque de fabrique, incluant un dialogue entre les différents partenaires qui se préoccupent de l’enfant et qui ne peuvent s’empêcher de se regarder en chiens de faïence. La qualité de l’environnement de l’enfant en dépend : prendre soin de lui s’articule avec le fait que la position psychopédagogique est une « émanation d’équipe » au sein de laquelle chacun pourrait être le porteur de son désir. La reconstitution d’un espace familial élargi, comme Anna Freud en son temps avec l’école d’Hietzing, fait partie de l’aventure et de son climat. Dans des coins plus sombres, on trouve aussi l’interdépendance affective. Comme l’étoile, l’angle peut paraître mort, mais une mort sans doute annoncée prématurément : l’atelier de français ou de mathématiques, de théâtre ou de poésie, ne peut être dissocié du travail effectué dans un internat de province par le menuisier, pilier officieux de l’institution. Suivant ce fil métaphorique, les adultes se retrouvent dans des « réunions de chantier » qui fon(den)t le ciment institutionnel. Cette culture du lien serait pourtant vaine sans la valeur de l’expérience, ici celle de l’internat.
Parce que c’est là que veut nous emmener finalement J.-P. Bigeault, avec un ton léger assumant sa différence. Dans le récit de cet internat qu’il dirigea il y a quelque temps déjà, il revisite l’importance d’une collégialité partagée : les enfants sont impliqués dans une commission des menus et ainsi, à petites touches, on voit émerger de l’ombre une atmosphère et sa flagrance. La vie passe, par exemple, à travers la construction de « journées à vivre ».
Par cet écrit humaniste loin de tout langage technique, J.-P. Bigeault raconte avec style les petites histoires qui composent le puzzle institutionnel. Ici, l’histoire d’un vol, là celle d’un incendie. Cet incendie allumé par un adolescent apparaît comme une tragédie – les bâtiments scolaires brûlent, on démissionne, l’illusion apparaît dans sa crudité, nue. En même temps, cet incendie agit comme un révélateur, à la façon dont un événement peut éclairer la nuit pour en démasquer les ombres. Médiation, marge, interstice, autant de mots creux s’ils ne sont pas accompagnés d’une expérience ; ici, dans cet internat, entre les murs, entre les mots, le double sens propre au langage de l’inconscient circule régulièrement : comment ne pas entendre que l’existence d’une grotte, à côté de l’internat, fait office de refuge ou d’espace véhiculant les angoisses de chacun ?
La pratique institutionnelle avec des adolescents ressemble souvent à une grotte à traverser, chaque son produisant une série de résonances pour chacun. Comme un écho de grotte, la culture de la séparation traverse à la fois la pratique institutionnelle et la problématique de tout adolescent. Peut-on exercer son art, de pédagogue, de psychothérapeute ou des deux, sans être proche de son adolescence, non pas dans une complicité que les adolescents dénonceraient sans concession, mais pour mieux entendre les vents contraires qui les agitent ? Pour éduquer, il serait nécessaire de conserver une certaine mobilité, pour transformer un savoir ou une technique en processus créatif. Les prises de décision baroques ne sont alors jamais loin ; cet adolescent qui crache sa désespérance aux visages médusés des éducateurs, il lui sera paradoxalement ordonné comme sanction de dire enfin, une fois pour toutes, tout le vocabulaire grossier à sa disposition, de donner toute sa place au fumier qui l’anime. Sous l’apparent absurde, l’humour perce et donne sa chance à celui qui déroge. De la même façon, comme A. Aichhorn le fit en son temps, donner la responsabilité d’un magasin – ici une buvette, là du tabac – à un adolescent qui a commis un vol fait glisser les lignes d’horizon, déplace et remobilise, dans la confiance d’un lien sécure et non menaçant.
Entrez dans cette danse, on en ressort ahuri devant l’audace, et joyeux face à l’absence de tout cynisme qu’implique cette poétique de l’art éducatif : une certaine dose de risque. N’ayez crainte, entrez dans la grotte.
Florian Houssier,
psychologue, psychanalyste et maître de conférences (hdr) à l’université Paris-Descartes.
In EMPAN 2011/4 N°184